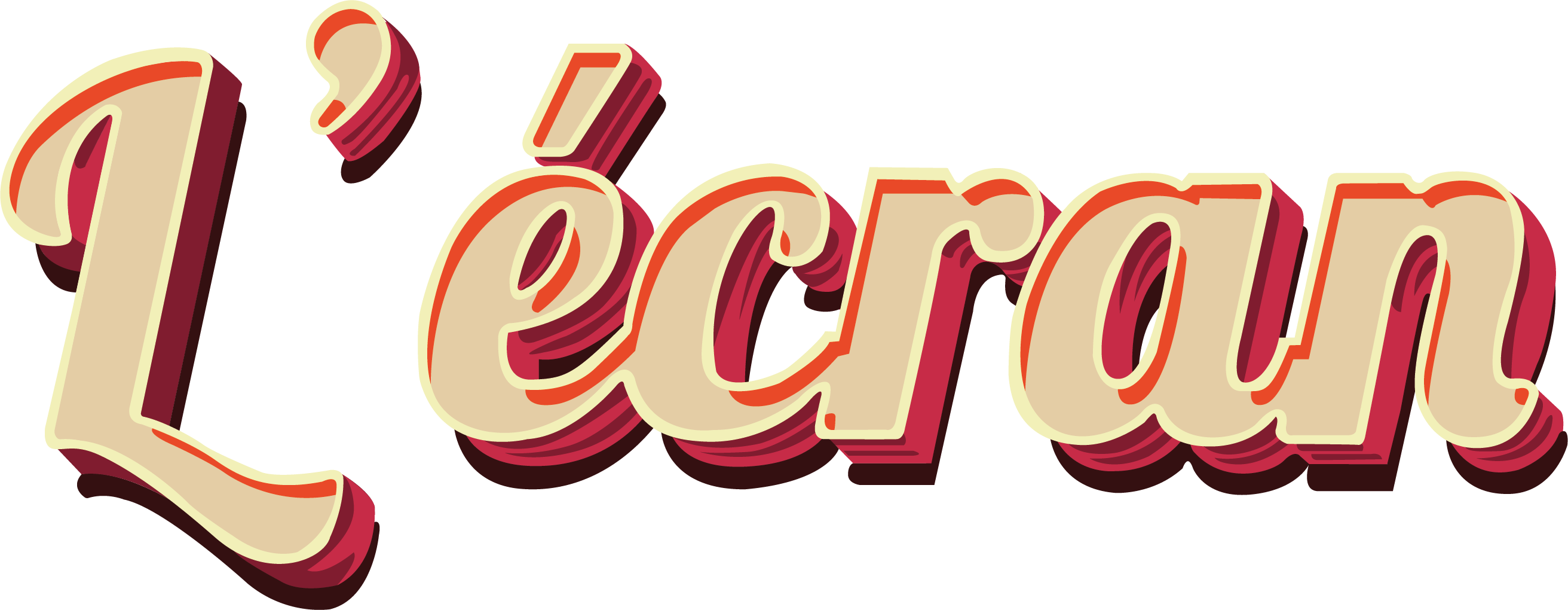Étienne Garcia est le fondateur du Festival International du Film de fiction historique. À la fois passionné d’Histoire et de cinéma, il s’est investi depuis maintenant dix ans pour faire vivre cet événement implanté sur la commune de Plaisance-du-Touch, à l’ouest de Toulouse. Pour sa onzième édition (du 24 au 27 septembre 2025), une programmation de qualité et des invités exceptionnels sont à l’ordre du jour, prêts à toucher tous les publics, y compris les plus jeunes. Nous avons eu la chance de pouvoir échanger avec lui sur la place et l’importance de la fiction historique comme vecteur de rêve, mais aussi de transmission et de pédagogie auprès des nouvelles générations.

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et nous en dire plus sur votre formation initiale ?
Je suis originaire de l’Aude et je suis né en 1990. Adolescent, je suis entré au lycée, option cinéma, à Pézenas (dans l’Hérault, ndlr). J’ai ensuite entamé des études de production à Roubaix. J’ai aussi obtenu une licence de cinéma à la Sorbonne. Depuis, j’ai travaillé dans le milieu de la production, et je suis intermittent. J’ai lancé l’idée du FIFFH (Festival International du Film de Fiction Historique) en 2014, et la première édition a eu lieu en 2015. J’avais envie de partager le plaisir de la diffusion à ma mesure, et notamment avec les jeunes. J’ai été émerveillé par le cinéma lorsque j’étais enfant. C’était pour moi un endroit hors du temps. Le festival a été créé à Narbonne, puis déplacé pour des questions politiques à Plaisance-du-Touch depuis 2016. J’ai organisé plusieurs autres festivals, dont celui du Film politique à Carcassonne et j’ai également réalisé un film l’an dernier pour la première fois, un documentaire.
Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre rapport au cinéma ? Comment cette passion a débuté ?
La mère d’une copine de classe nous proposait d’aller au cinéma le mercredi après-midi. J’y trouvais une sorte d’évasion et la sensation émotionnelle d’être envahi : le son tout autour de nous, la taille de l’écran, le noir, la notion du temps qui disparaît, le public à proximité… C’était un moment à part, quelque chose qu’on n’avait pas chez soi en regardant des films. Je suis vraiment de cette époque des Walt Disney avec des chansons, de ce courant des années 90. Ça m’a vachement marqué. Puis, je suis allé voir des films historiques assez tôt. Je pense au Bossu, avec Daniel Auteuil, par exemple, mais aussi à Lagardère, Zorro avec Antonio Banderas… Ce sont des œuvres qui m’ont marqué à huit ou neuf ans. C’était assez magique, mon inconscient fonctionnait beaucoup. Et puis je me rappelle des salles de cinéma que l’on trouvait en ville, avant. On n’allait pas dans des méga CGR. On allait au cinéma à pied. Cette idée de proximité et d’accessibilité m’a toujours plu, contrairement à maintenant où l’on doit souvent prendre la voiture ou les transports en commun. Avant, rien qu’en passant devant et en voyant les affiches, on pouvait avoir envie d’aller voir un film, il y avait cette “curiosité du trottoir”.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir le cinéma comme environnement professionnel ?
L’univers de la fiction, c’était devenu une évidence pour moi. Je trouve que la réalité est très vite limitée. On vit dans un monde anxiogène, et cette réalité ne fait pas rêver, hormis l’imprévisibilité qui amène parfois des flux d’adrénaline. Pour le reste, nous sommes dans une société qui consomme, qui n’a plus le temps de rien. À partir du moment où j’ai l’imaginaire, je me dis que la réalité s’ouvre à autre chose, et je me sens décoller. Je ne cherche pas le réalisme, pas du tout, car on le trouve déjà au quotidien toute notre vie. À côté de ça, les studios, l’ambiance, les décors, la magie, les cascades… tout ça me fascine. Ces gens qui sont artisans, créateurs, décorateurs, maquilleurs, ces gens qui transforment, eux aussi me captivent. J’avais envie de travailler avec eux et d’accompagner ces artistes dans ce monde de l’imaginaire. L’intermittence, c’est quelque chose d’extraordinaire. Je tiens à ma liberté et petit à petit, c’est peut-être aussi la profession elle-même qui se rapproche de nous, qui devient une évidence. Quand j’ai signé un CDI, j’ai été viré au bout d’une semaine car je voulais amener beaucoup d’idées, faire bouger les lignes, et on m’avait dit que je n’étais pas fait pour ça. Aujourd’hui, on peut avoir plein de gens autour de nous, être engagés dans des projets, et pas juste dans une profession. Quand tu es habité par ça, que tu restes en cours de cinéma deux heures après la fin pour poser des questions, pour fouiller dans la dvdthèque, c’est que ce qui te passionne ne te fatigue pas. On a la possibilité de ne pas subir ce qu’on fait dans notre travail, et c’est tant mieux. Je suis quelqu’un de très heureux, je ne manifeste pas, je ne suis pas en colère. Je vis. Mais j’ai pu gagner du temps via l’intermittence pour me nourrir de voir des films et pour mettre en avant des artistes.

Quel est votre rapport à l’Histoire, et plus encore à l’Histoire au cinéma ?
J’ai grandi dans une famille qui a une histoire riche, et dont le récit m’a passionné. Mes grands-parents, par leurs origines, ont vécu des événements historiques. Côté paternel, ils ont assisté à la libération de l’Algérie par les Américains en 1942, avant de fuir le pays vingt ans plus tard, lors de l’indépendance. Ce qu’ils m’ont raconté, c’est la petite histoire dans la grande Histoire. Côté maternel, ils ont vécu la guerre, tous les deux dans le Sud, et mon grand-père était présent lors de la libération d’Albi, alors qu’il était encore lycéen et membre de la Résistance. L’un de mes grand-oncles a hébergé Jean Moulin. D’autres récits de transmission, j’en ai eu de la part de mes aïeuls, qui m’en ont beaucoup parlé dans ma jeunesse.
Les films ont eux aussi une capacité de transmission quand les vrais acteurs ne sont plus là. J’ai toujours beaucoup aimé l’Histoire. On s’en nourrit énormément, puisqu’elle ne cesse de se répéter. On dit souvent que connaître son passé c’est anticiper l’avenir, et je crois beaucoup à ça. J’aimais déjà cette matière au collège et au lycée, je posais énormément de questions, j’étais curieux. Pour ce qui était d’en faire le thème du festival, je me disais qu’il n’y en avait pas d’autres dans ce registre, et qu’il fallait se distinguer en proposant quelque chose de singulier, pour attirer l’œil et faire ce qui n’avait pas été fait. Il fallait aussi pouvoir attirer toutes les générations, y compris les plus jeunes, puisque les programmes d’Histoire débutent dès l’école primaire. C’est un lien qu’on peut créer avec tout le monde. Ça n’aurait pas de sens, autrement.
Y a-t-il justement une époque historique qui vous parle plus qu’une autre ?
Paradoxalement, je pense qu’on a sur-étudié le vingtième siècle : en matière de fiction historique, on a eu beaucoup d’œuvres qui en parlaient. Personnellement, j’ai beaucoup aimé le dix-huitième siècle, et toutes les questions qui se sont posées concernant la société étudiée par les Lumières et le libertinage. Je pense aux Liaisons dangereuses, à ces romans qui se sont interrogés sur les castes sociales, mais aussi sur le pouvoir qui reste concentrée dans l’aristocratie, dans une organisation, une structure où on marie les gens entre eux, où tout est lié à la caste et non au mélange. Aujourd’hui, on n’en parle pas tant que ça, alors que c’est une problématique bien actuelle. La bourgeoisie est incapable d’envisager une vie commune avec le peuple, et c’est ce qui se passe en politique. Les Lumières ont étudié ça : qu’est-ce que c’est l’aristocratie, la bourgeoisie, le peuple, le clergé ? Qu’en est-il de la remise en question au sujet de la distribution des pouvoirs ?
Pour le côté artistique, j’apprécie l’Angleterre victorienne. Je suis fan des films fantastiques burtoniens, de Murnau, de l’expressionnisme du dix-neuvième siècle. Ces ambiances avec des rues enfumées, je trouve que c’est une belle esthétique.
Est-ce qu’il y a des pépites en matière de cinéma historique que vous souhaiteriez partager et qui n’ont pas eu le succès qu’elles méritaient, selon vous ?
Oui, certains films sont sortis au mauvais moment ou n’ont pas eu le succès qu’ils attendaient, comme Les Leçons Persanes. Il s’agit de l’histoire d’un Juif français qui comprend l’allemand et se fait passer pour un Perse. Lorsqu’il entend dire que le capitaine SS désire apprendre le farsi, il décide de mentir et d’inventer une langue pour essayer de s’en sortir. J’ai adoré. Le film est sorti en pleine pandémie et n’a pas marché du tout. Quand on a la chance de tomber sur des œuvres comme ça, c’est génial. Après, j’ai quand même l’impression que beaucoup trop de films sortent, par rapport au public et à ce qu’il peut voir. Entre ce qui sort au cinéma et sur les plateformes, la sélection se fait par rapport au temps de la vie. Les impératifs sont de plus en plus écrasants, et on n’a pas forcément l’occasion de découvrir tout ce qui est diffusé. Je fais moi-même partie des gens qui vont très peu au cinéma, tout simplement parce que je n’en ai pas le temps. Le fait d’organiser un festival dans cette thématique me permet aussi de déplorer le manque d’exposition pour telle ou telle production. C’est le but des festivals, que de surexposer des films qui auront moins de portée en salle, mais qui bénéficieront du bouche-à-oreille et qui auront permis au public de les rencontrer. Parce que c’est quoi sept-cent mille entrées, un million d’entrées, finalement ? On a du mal à analyser des chiffres comme ça. Même lorsqu’ils sont diffusés à la télévision : le film a fait deux millions et demi de téléspectateurs, d’accord, et puis ? En festival, on possède cette sorte de liberté, de projeter un long-métrage hors contexte de sa sortie en salles. On est sur un emploi du temps de quatre jours très particulier, qui nous permet de remplir des grosses salles dans le cadre de l’événement.
Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le documentaire intitulé Rose que vous avez réalisé ?
Le film parle d’un joueur de rugby, Cédric Rosalen, mort brutalement le 9 janvier 2024, à 45 ans. C’est quelqu’un que j’avais vu jouer au rugby plus jeune, et qui m’avait marqué. J’en ai parlé à la famille, et nous avons lancé un crowdfunding. Nous avons obtenu 850 contributeurs. On a pu le présenter dans pas mal de salles, pour rendre hommage à quelqu’un qu’on ne voit pas. Le sujet du film n’est pas dans le film. On est sur un documentaire qui tire vers la fiction, parce que je l’ai écrit comme tel, même si les personnages sont bien réels (à l’exception de l’un d’entre eux). C’est un genre hybride, une sorte de voyage initiatique. C’était ma première expérience de réalisation, mais j’ai été encouragé. C’est très dur, mais quand on est habité par quelque chose, il faut aller au bout.

Est-ce que vous comptez renouveler l’expérience ?
J’ai trouvé ça génial. Si je suis habité par un sujet comme ce fut le cas pour Rose, alors ça peut être intéressant, mais il faut vraiment que je sois passionné. À mes yeux, pour réaliser, il faut que ça vienne du fond de vous. Ça ne doit pas être un exercice scolaire pour lequel on doit bêtement respecter des étapes. On ne réalise pas n’importe quoi n’importe quand. J’adore la question du dépassement de manière générale, et il y a plein de sujets qui pourraient m’inspirer. Pour Rose, c’était vraiment un projet atypique, car il était financé avant même d’être écrit. J’ai eu l’idée en janvier, je l’ai écrit et financé en mars, et il a été tourné en juin. Quand ça va vite comme ça, c’est super. Mais quand vous avez des années d’attente pour obtenir des réponses et savoir si vous pourrez aller au bout, c’est très compliqué, ne serait-ce que pour réussir à conserver sa motivation.
Quel bilan faites-vous des dix dernières années du FIFFH ?
Je trouve que c’est déjà merveilleux d’en être arrivé là. Quand on démarre un projet comme celui-là, on ne sait pas jusqu’à quand ça va continuer, parce qu’on doit toujours se battre pour arriver à revenir. C’est une bataille financière, et il faut pouvoir convaincre, ce qui reste un problème. Je trouve aussi que la société a changé en dix ans. Celle avec laquelle nous avons démarré était très différente. On était en 2015, en plein cœur des attentats. C’était bien avant Nice, avant le 13 novembre, mais après Charlie Hebdo. C’était une société où on avait besoin d’Histoire, où on parlait beaucoup des fondements de la laïcité, de sa place dans la République. Puis tout s’est effondré, avec le covid et des considérations économiques. Pour ce qui est du traitement de l’Histoire aujourd’hui, les dispositifs ne sont plus les mêmes. Les priorités sont tout autres, et l’éducation n’en fait plus partie, de ce que je peux constater. Aujourd’hui, on est dans de la gestion, pas dans de la conviction éducative. Pourtant, c’est bien dans ce type de société qu’on a encore plus besoin de savoir d’où on vient. Quand on vit des difficultés sociétales, il y a une vraie confusion quant à nos racines, notre vision du monde. On remarque une perte de sens et du chemin à suivre. Selon moi, parler d’Histoire aux jeunes est primordial, pour éviter que les choses ne se répètent et qu’on se retrouve dans une configuration où le populisme l’emporte sur tout. On a besoin d’une base, d’un socle solide concernant notre connaissance du passé. Au moment des attentats, l’éducation civique avait une vraie importance. On se rend compte à présent que cet enseignement a été un peu délaissé, “en haut”.
De la même manière, en 2015 les plateformes de streaming n’étaient pas aussi installées que maintenant. La télévision est regardée par une branche de la société, et plus par d’autres. Avant, pour ce qui était du cinéma français, les dix plus gros succès étaient des comédies. Aujourd’hui, elles marchent beaucoup moins bien, excepté pour quelques long-métrages comme En fanfare, qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. Le cinéma, c’est devenu très cher, et les gens n’ont plus forcément envie d’aller y voir des comédies qu’ils peuvent voir chez eux. Le film historique possède encore une profondeur qui le rend un peu plus légitime.
Concernant le FIFFH, la flamme est toujours aussi présente, et je dirais même encore plus quand je constate l’évolution des choses et tout ce qu’on entend comme discours, comme réinventions et réécritures de l’Histoire de la part de ceux qui veulent s’accaparer le pouvoir. Il y a tellement de fake news, les canaux d’information sont encore plus présents, entre les chaînes d’info en continu et les réseaux sociaux… La capacité de tout vérifier s’est complexifiée. On est sur de l’information sans aucun recul, parce qu’on est dans l’immédiateté, dans le fait de maintenir les gens dans une angoisse permanente. C’est une sorte d’américanisation des choses. Le festival, lui, permet justement d’arrêter le temps, de se concentrer sur un film qui se focalise sur une époque.

En quelques mots, qu’est-ce qu’elle vous évoque cette onzième édition ?
Souvent, une édition succède à une autre. Celle-ci s’annonce différente. Il y a une vraie rupture, parce qu’on doit se réinventer après une décennie, parce que je n’ai plus le même âge, aussi. On sait qu’une décennie, c’est une accumulation : on n’a plus la même énergie qu’avant, mais on a aussi beaucoup plus d’expérience. On invente autre chose, je crois. Il y a comme une respiration, une liberté, une prise de recul. On a besoin de prendre de la hauteur, d’où le ballon sur l’affiche de cette édition. J’aime bien cette esthétique. On n’est plus dans la bataille du début, où on avait un mal fou à obtenir la confiance des distributeurs afin d’avoir des films à projeter. On a touché 23 000 élèves en dix ans. Les premiers enfants sont devenus des jeunes adultes aujourd’hui, et ils ont grandi avec le FIFFH. Tout ça, c’est un chemin de vie, que de faire connaître ce projet sur l’ouest toulousain et d’arriver à en faire un rayonnement. De voir une équipe grandir, des gens partir, des gens arriver qui veulent apporter quelque chose à cette nouvelle décennie, celle de la maturité. On a réussi à proposer cette diversité, cette liberté de pouvoir programmer des films plus exigeants, parce qu’on sait désormais qu’on est suivi par un public. Et quand vous avez la confiance du public, vous avez tout gagné.
Je tiens à remercier chaleureusement M. Garcia pour son temps, et pour nous avoir proposé de devenir partenaires presse officiels du FIFFH. Retrouvez la couverture de l’ensemble du festival sur le site de L’Écran et sur nos réseaux sociaux !