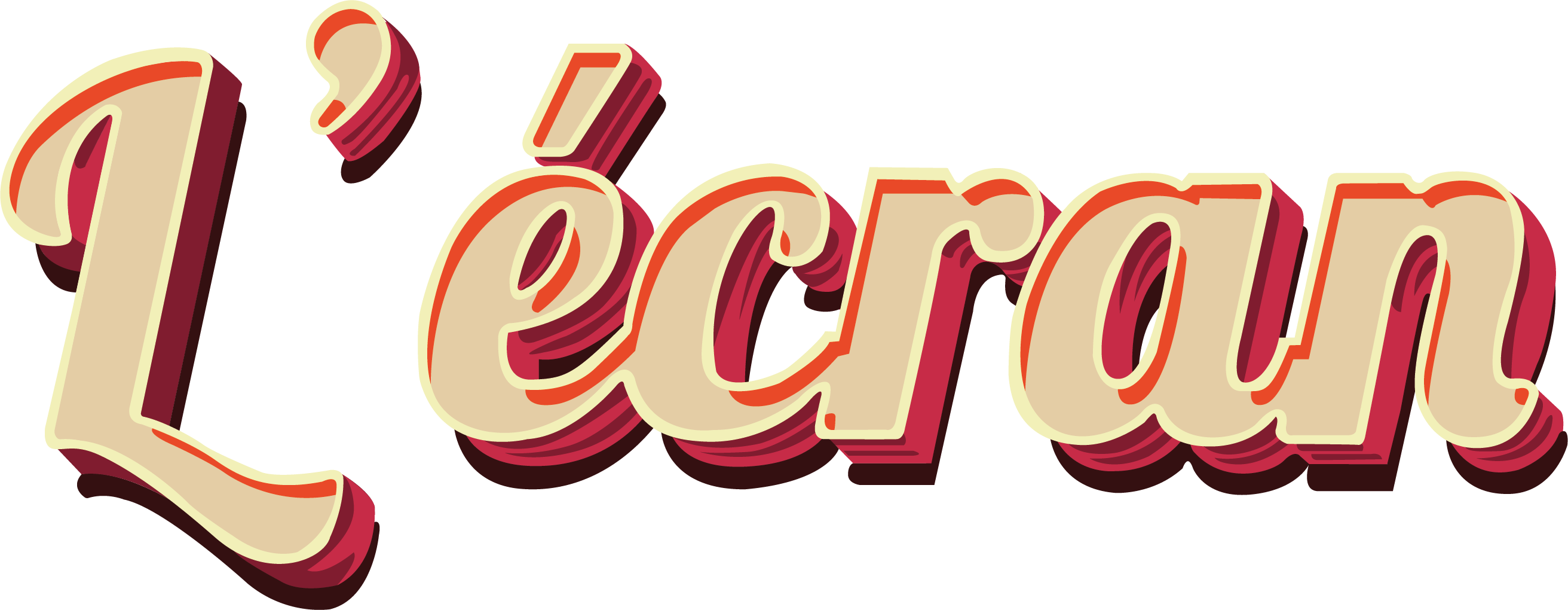La filmographie d’Emmanuel Finkiel se distingue par sa vision acérée et hantée sur la Shoah. La Chambre de Mariana conclut la trilogie initiée par le réalisateur, d’abord avec Voyages, suivi de La Douleur. Le long-métrage voit ici Mélanie Thierry incarner Mariana, une prostituée ukrainienne qui accepte de cacher et de protéger dans sa chambre un jeune garçon juif, du nom de Hugo. Premier film projeté dans le cadre du Festival du Film de fiction historique, ce huis clos poignant et singulier plonge ses spectateurs en pleine Europe de l’Est et notamment en Ukraine, déjà à l‘époque déchiquetée de toutes parts. Entre la terreur inspirée par l’Allemagne nazie et les crimes commis par l’armée russe, retour sur cette adaptation sortie en avril 2025 dans les salles françaises.
La Chambre de Mariana se distingue sur plusieurs points, à commencer par le talent phénoménal de son duo d’acteurs principaux. Mélanie Thierry, tout d’abord, s’est totalement fondue dans la peau de cette fille de joie troublée et troublante. Son regard comme son sourire sont fatigués. Son corps l’est à peine moins. Sa démarche n’est pas toujours sûre, et sa bouteille de gnôle n’est jamais très loin. De la tête aux pieds, à l’aise dans son manteau agrémenté de fourrure comme nue ou en déshabillé, Mariana évolue dans cette chambre dont les murs se font tour à tour refuge et prison. Tantôt brusque, tantôt gracieux, le personnage attire par sa présence magnétique, sa mélancolie touchante et sa détresse manifeste. Dès les premiers instants, alors que son protégé trouve un abri de fortune dans son placard, c’est par ses yeux que la caméra nous la présente, ainsi que par l’utilisation d’une contre-plongée discrète, mais subtilement impactante. C’est par ses yeux qu’elle nous apparaît dans toutes ses (très) nombreuses facettes, dont chacune évoque une humeur, un moment, une caresse, un ordre, une plaisanterie étrange. Cette fascination ne meurt jamais, que la jeune femme soit visible ou non. Mélanie Thierry se transcende, parle un ukrainien parfait (appris pendant deux ans, loin des usages de l’IA pour renforcer l’authenticité d’un Adrien Brody dans The Brutalist), et qui pourrait faire douter de son français natal. Sa voix et ses intonations, ses caprices comme sa bienveillance, font d’elle la pulsion de vie suprême au milieu d’un paysage extérieur hostile, baigné dans cette lumière maladive ou bleutée que les rayons du soleil ne parviennent jamais vraiment à trouer ; les uniformes vert-champêtre de la Wehrmacht s’y fondent à merveille. Rapidement, en comparaison aux souvenirs de l’existence révolue du garçon, elle se substitue aux autres figures féminines, pour les remplacer toutes — sans pour autant les annihiler — au fur et à mesure que sa mère, son amie, l’ancien monde, disparaît sous les persécutions antisémites. Mariana devient le féminin sacré, capable d’embrasser tous les “rôles” pouvant entourer Hugo. Elle se fait mère attentive, veillant à le nourrir et à lui fournir un cadre protecteur, pour mieux régresser et se faire capricieuse et immature quelque temps plus tard, allant jusqu’à lui confier la mission de veiller sur son sommeil, ou sommée par lui de cesser de s’alcooliser.

Peu à peu, elle semble même se transformer en personnage de conte, se faisant dragonne couvant son trésor dans les hauteurs de cette chambre-forteresse qu’elle rend inaccessible au mal. Considéré comme un enfant, voire comme un “chiot” dont le jeune âge le préserve encore des comportements violents masculins à l’égard des filles de joie, Mariana dépasse les bornes, souvent, et choque jusqu’à nous rendre craintifs de ses pulsions discutables. Au fil de l’histoire, certains propos se font de plus en plus ambigus, allant jusqu’aux contacts rapprochés entre une femme adulte — prostituée de surcroît — et un gamin à peine sorti de l’enfance. Des rapports de jalousie et de possessivité se développent au sein de cette chambre étroite et forcément sujette à une promiscuité aussi bien rassurante que destructrice. L’intimité, poussée à un point indicible et rarement assumée sous cette forme au cinéma, est ici impressionnante de justesse, tant les deux acteurs ont atteint un degré d’harmonie remarquable. L’audace paye, tout comme le choix extraordinairement judicieux de casting pour Artem Kyryk, dont la maturité de jeu et l’expressivité auraient de quoi rendre humbles bon nombre de ses aînés à Hollywood. Cette relation secoue, et le secret de leur lien est d’autant plus renforcé par la violence et la menace de ce dehors que tous les deux fuient. Cette chambre honnie devient paradoxalement leur seule échappatoire, les dernières chances de grappiller tendresse, chaleur humaine et sauvegarde psychique comme psychologique.

Au-delà de ce nœud d’amour formé par ses protagonistes, Finkiel est sans concession en ce qui concerne le désastre de la guerre. Par des procédés déroutants et une utilisation de la temporalité et de la mémoire assez habiles, le réalisateur s’exprime, révélant à quel point les souvenirs vécus entre 1939 et 1945 se construisent vaille que vaille, se figent et se mélangent, confondent l’espace-temps, et notamment de la part d’un enfant encore en pleine évolution. Le passé et le présent laissent la place au fantasme, au rêve ou au délire, mais jamais à l’avenir, ou si peu. Au fur et à mesure que la mort prend toute la place et que l’univers, à l’inverse, se rétrécit, l’absence d’éducation et la vie coupée du monde poussent l’individu au repli sur sa souffrance, à la fermeture, à l’explosion ou à la contrition des sentiments, dans des explosions forcément douloureuses. Le public reçoit de plein fouet les conséquences de cette enfance sacrifiée, et surtout la peur omniprésente (de ne pas manger à sa faim, de perdre son refuge provisoire, de ne jamais revoir ses parents, ses amis, de perdre le peu qu’on a réussi à préserver autour de soi). Certaines scènes en deviennent insoutenables de tristesse, comme celle d’un anniversaire passé en famille, mais caché derrière rideaux et volets, dans l’obscurité, et dans les applaudissements silencieux. Celle aussi d’une vision hallucinée : père, mère, grand-parents, aïeux, fixant Hugo dans la pénombre de son placard, dernier survivant d’une famille entièrement massacrée. Par la caméra de Finkiel, l’Ukraine, plus que jamais, est cette terre restée maudite par la faute de calamités successives, avant ou après le conflit. La place de la femme reste un sujet central du long-métrage. L’envahissement du féminin est total, qu’il s’agisse des vêtements et des chaussures de Mariana éparpillés partout dans la pièce, de la menace relative que constituent les femmes de la maison close (de la cuisinière jusqu’à la patronne), de ce bloc qu’elles forment autour d’un gamin tout autant sujet à l’objet des moqueries comme de leur concupiscence, toutes apportent leur pierre à l’édifice de sa protection, sans pour autant toujours faire preuve de morale. Car au-delà de la séduction, leur désir est aussi celui d’une protection recherchée après la guerre ; se faisant payer en bijoux donnés par la mère de Hugo en guise d’offrande à Mariana, ou voulant utiliser le petit pour se prémunir de la violence russe, exécutée au-travers de soldats n’hésitant pas à “faire payer” les complices des Allemands, prostituées comprises.

Finkiel filme la détresse et la solitude de ses personnages avec splendeur, au moins aussi bien que leur désir de survivre coûte que coûte. Son style est simple, sans fanfreluches. La Chambre de Mariana s’étire dans le temps, et dans la lenteur de ses plans qui ne le rendent jamais ennuyeux pour autant. Il parvient surprenamment à faire ressentir à ses spectateurs à quel point les semaines et les mois s’écoulent lentement, quand chaque heure rend possible d’être exposé au danger et l’attente perpétuelle : l’attente du client, l’attente d’une rafle, l’attente que la guerre finisse, que les Russes arrivent, que l’espoir revienne.
Un petit bijou de cinéma ciselé, bouleversant et maîtrisé, de la part d’un artiste habité, justement, par la douleur de ses personnages.