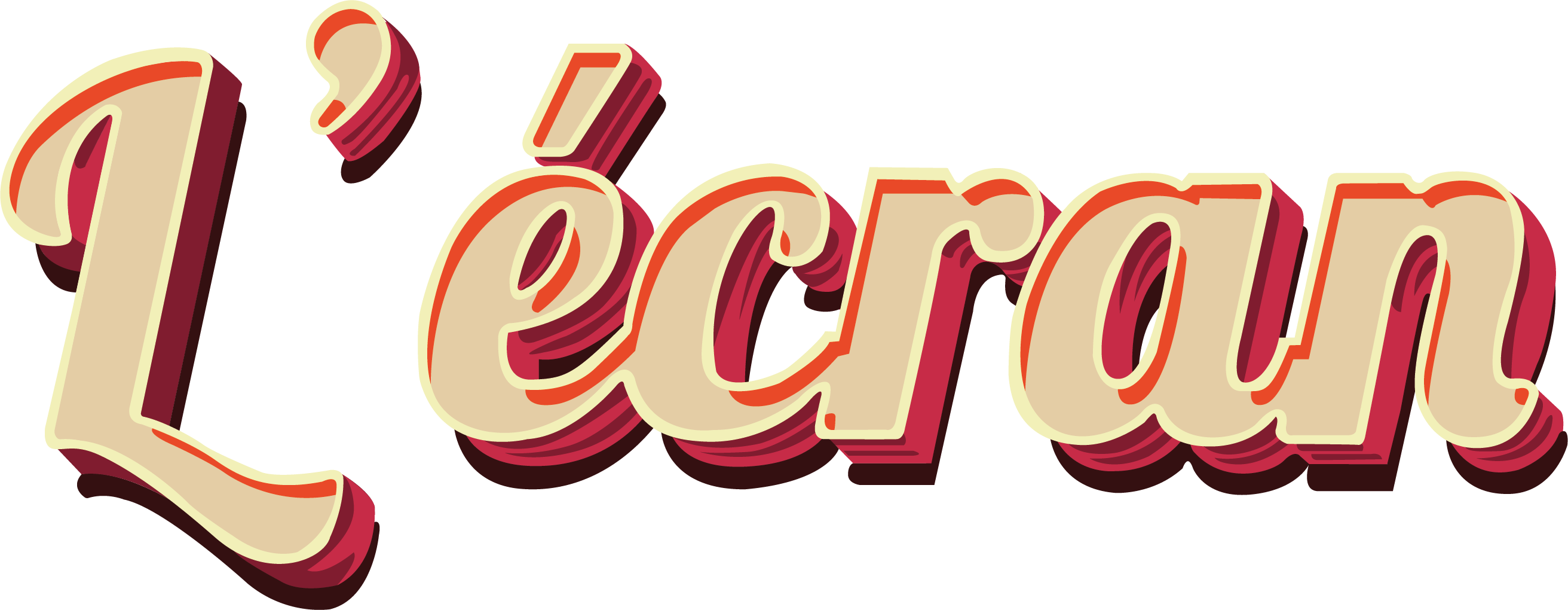Jean Valjean est le nouveau film d’Éric Besnard, dont la sortie est prévue pour le 19 novembre 2025. Loin de compter comme une énième adaptation d’un grand héros littéraire, le parti pris du réalisateur est parfaitement cadré : évoquer le protagoniste les jours suivant sa libération du bagne, au bout de presque vingt ans de captivité. Ce film, sélectionné comme le coup de cœur du FIFFH 2025, est devenu le nôtre, car porté par des acteurs époustouflants, des décors plus vrais que nature, et une vision précise et maîtrisée de l’œuvre de Victor Hugo. Cette critique est une déclaration d’amour, et une invitation à le découvrir prochainement en salles.
“Intime”. C’est l’impression qui vient d’office percuter le spectateur, lorsque les premières images apparaissent à l’écran. On s’attache aussitôt à la silhouette de ce personnage si bien connu, et interprété pas moins de vingt-cinq fois, au théâtre comme au cinéma. Cet acteur-là fera la différence. Grégory Gadebois marche. Il incarne de toute sa masse un être détruit, accablé par la méchanceté des hommes, par l’injustice née de la pauvreté, et par la si lourde peine infligée, tout cela au nom d’un crime nécessaire : le vol d’un pain pour nourrir sa famille affamée. Les paysages du sud-est de la France sont tout relief et colline, pierre brute et forêts de bois sec. Majesté. Le ciel, zébré de rose, reste de marbre, face à la rugosité du personnage déformé par la prison et les châtiments. La hargne qu’il employait dans ses tentatives d’évasion s’est changée en colère profonde. Même les éléments ne l’épargnent pas : aux montées pénibles, la pluie s’ajoute. Au soleil implacable, le vent froid qu’on devine dans les ruelles de Digne. Un chien attaque, et s’aperçoit un peu tard que l’humain qu’il cisaille est en réalité plus bestial encore que lui. Misérable mais guère pathétique, Jean Valjean saisit, et se montre parfaitement à la hauteur de la légende. Mieux, il la transcende. Gadebois est volumineux et pourtant leste, et ses prunelles tourmentées toisent le monde et tout ce qui bouge. L’échine basse, il ressemble à un molosse qui a trop été battu, et qui n’attend que la bonne occasion pour mordre en retour. Par un jeu d’acteur naturel et instinctif, il transpire de cette méfiance d’animal traqué, que l’on ne peut que trop comprendre, et suscite une empathie qui n’a pas besoin de procédés artificiels pour rendre le personnage plus sympathique. Il ne l’est pas. Il ne peut pas l’être, car son Mal est trop profond. Et pourtant, Monseigneur Bienvenu sait que la réparation est possible.

Le travail de reconstitution, en particulier remarquable, ne laisse la possibilité à aucun effet maquillé de se substituer à ce dix-neuvième siècle plus authentique que jamais. La magie du cinéma opère à merveille, grâce au talent délicat de toute une équipe technique appliquée et visiblement sensible aux détails. Les maisons sont dépouillées de réel confort, et notamment celle de Monseigneur Bienvenu, évêque et seul hôte acceptant d’accueillir l’ancien bagnard. Les plans fixes de Besnard permettent au regard de s’attarder sur l’agencement des murs, sur la simplicité d’une table en bois, d’un lit aux draps blancs, sur les ustensiles de cuisine. Ainsi qu’on le voyait dans les vieux usages, la vache loge à l’intérieur, près du foyer. Pour une fois, il n’y a rien du fantasme, de l’image d’Épinal que les fictions successives ont imprimé dans les esprits. Le dix-neuvième siècle est âpre et sans apparat : il y fait froid, il y fait faim. Le film fait preuve d’un naturalisme que n’auraient pas boudé les grands auteurs contemporains de cette histoire, revisitée par un œil attentif et que l’on devine ému par les personnages de Victor Hugo. Cet hommage se retrouve aussi dans l’écriture des dialogues, et on pourrait en citer beaucoup, parmi tous ceux habilement glissés entre les différents protagonistes. Dans la bouche de Gadebois, Campan, Carré et Lamy, le parler d’antan recouvre ses couleurs, se pare de la rancune tenace, de la défiance face à l’étranger, de la charité offerte et de la sagesse populaire.
L’hostilité :
“Je me contente de peu ;
— C’est déjà trop.”
L’enfer des travaux forcés :
“Dieu est partout.
“— Pas là-bas.”
La beauté d’une nuit calme :
“J’aime ces moments. Ils me font accepter l’infini.”
La désespérance :
“Il jugea la société et la condamna à sa haine.”
Cette rusticité, de plus en plus rare pour le cinéma français, est perceptible jusqu’à la facture impeccable des costumes ; elle ne triche pas. Elle se révèle aussi sur les figures des personnages, par des silences dosés, et des discours nécessaires. Pour autant, le style du réalisateur, lui, s’adapte parfaitement à notre modernité. La narration ne manque pas de détours, grâce à l’utilisation de flashbacks très à propos, tout en restant très claire.

Qu’il s’agisse de se replonger dans la mémoire de l’évêque ou de son personnage éponyme, Jean Valjean ne se contente pas du huis clos, ne surjoue pas une mise en scène théâtrale. Le film s’élève dans les crêtes au profit d’un échange plein de raison entre un homme d’Église égaré et un ermite au crépuscule de sa vie. Il retourne dans l’enfer du bagne, sans nécessité d’agiter le fantôme d’un Javert ici aux abonnés absents. Le bagne et sa symbolique cruelle, où les prisonniers vêtus de rouge tranchent fort avec la pierre blanche de la carrière poussiéreuse, où les corps et les esprits s’échauffent, s’ennuient, s’épuisent. Le sang versé pour rien, au nom de l’Autorité faussement pure, quand la corruption, pourtant, salit ceux qui se proclament honnêtes gens, voire gendarmes. La composition musicale de Christophe Julien, tantôt discrète, tantôt tonitruante, mais toujours saisissante, souligne avec beaucoup d’élégance les remous intérieurs des personnages et les revers du destin.
Les questions du pardon, de la méchanceté de l’Homme qui n’est pas innée et qui n’est pas forcément prédestinée à devenir sa nouvelle prison, tout comme les interrogations sur la haine envers un monde qui le rend bien à Valjean, sont développées avec soin, tissées par Besnard qui crée les conditions de l’intime. L’intime, il est partout, sous le toit de cette maison d’abord vouée à réparer ou soulager les organismes malades, puis désormais, à apaiser les tourments du cœur enragé. Les jeux de lumière, par les reflets des flammes, de la lune, des chandelles, dessinent des arabesques tout en ombres et en contrastes, révélant le morcellement des âmes, jamais toutes blanches, jamais toutes noires.

On pourrait penser que Jean Valjean est l’anti Comte de Monte-Cristo. Ce n’est pas totalement faux. Mais au-delà de simplement opposer deux histoires, deux projets de cinéma mettant à l’honneur un héros de la littérature française, Éric Besnard signe une création bouleversante. Il offre une voix nouvelle à cet auteur que la France continue d’honorer, et à juste titre : Victor Hugo. Le réalisateur délivre un plaidoyer éternel en faveur du genre humain et de la foi. En Dieu, en un avenir meilleur, en l’amour que l’homme peut donner sans compter à son prochain. Ce film est un poème, une ode à la vie, au cinéma comme à la littérature, aux siècles passés et à cette France disparue, dont il ne reste que quelques souvenirs couchés sur le papier et les gravures. Et il n’est pas besoin d’avoir lu Les Misérables pour finalement se sentir pleurer avec Jean Valjean en proie à son épiphanie. Sa Réparation.
“L’histoire d’un homme n’est pas seulement celle d’un homme, mais aussi celle de ceux qu’il rencontre.
Ils vous rendent l’innocence.”