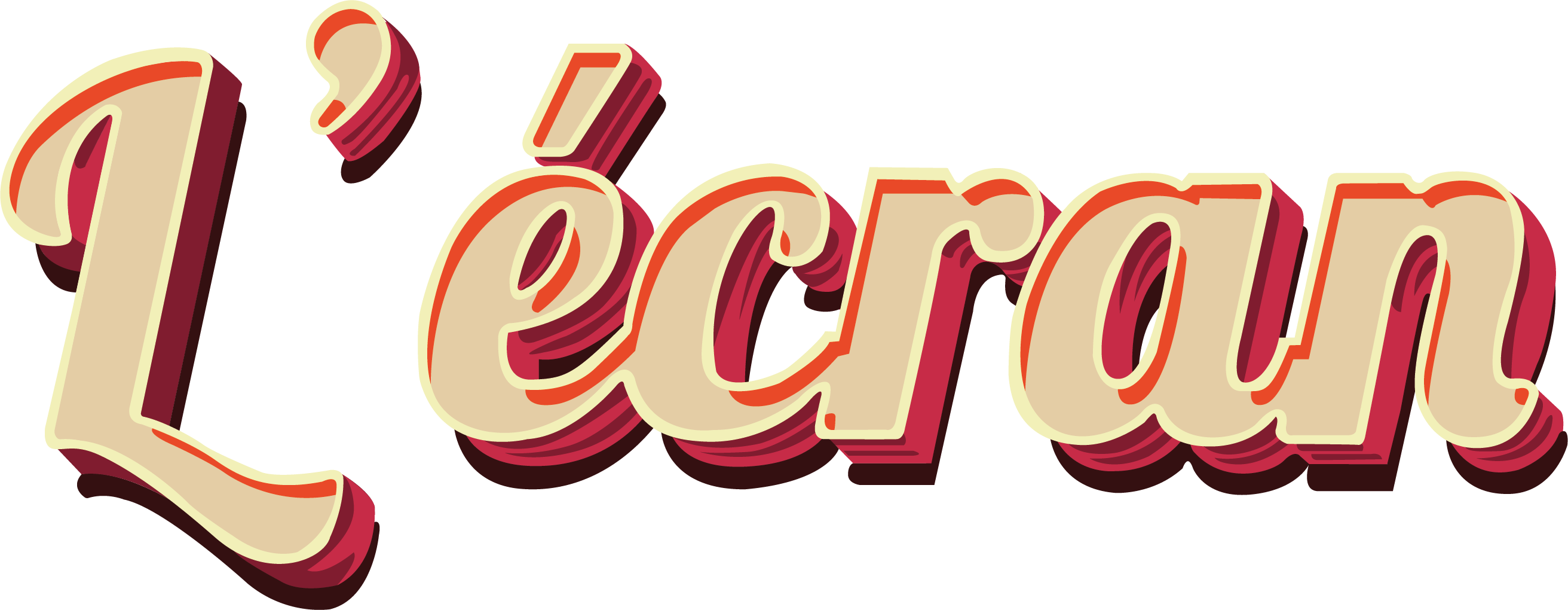Vous avez bien lu le titre de cette critique. Alors que Jurassic World Rebirth est sorti dans les salles de cinéma françaises le 4 juillet, le titre annoncé rendait déjà songeurs ou dubitatifs bon nombre de fans de la franchise (s’il en reste). À l’image des Resident Evil et autres pompes à fric hollywoodiennes dont chacun des épisodes se voit affublé d’un titre pompeux et souvent obscur, Jurassic World n’échappe pas à la tradition. Le film, réalisé par le très intéressant Gareth Edwards (Star Wars : Rogue One, Godzilla), promettait une nouvelle vision, un autre cadre pour les fans de dinos laissés pour compte après l’insupportable Dominion de 2022. Le pari était périlleux, compte tenu de l’état dans lequel Colin Trevorrow et Juan Antonio Bayona ont laissé les volets précédents. Alors qu’une chronique en deux parties sur la saga s’apprête à sortir sur notre site, retour sur ce qui apparaît malheureusement comme la déception de trop.
Pourquoi est-ce qu’on dit oui ?
Avant de tirer sur l’ambulance, il faut faire preuve d’une certaine honnêteté intellectuelle : tout n’est clairement pas à jeter dans le film de Gareth Edwards. Ce dernier, sans doute lucide quant aux déceptions et aux nouvelles “attentes” du public, n’a pas hésité à jouer la carte du fan service, et pour une fois, avec raison. Profitant des failles des précédents opus, et surtout du manque d’ambition et de créativité abyssal ayant conduit au désastre, il emprunte des pistes laissées jusqu’ici inexplorées. En effet, le trailer présentait Rebirth comme un film d’action et d’aventure presque à l’ancienne, à la mode années 2000 et avec un soupçon d’ADN d’Indiana Jones. Grandes prétentions, grandes preuves : Edwards dégaine un argument massue, à savoir le mosasaure resté tragiquement inexploité depuis deux films, pourtant brillamment introduit dans Jurassic World. Rebirth, enfin, se permet d’exposer aux fans quelques scènes d’angoisse maritime de bon aloi, avec naufrage et attaques à la clef. De quoi donner le ton, et offrir l’espoir que le long-métrage conserverait une qualité et une efficacité similaires.
Pour perpétuer la tradition de la première trilogie des Jurassic Park, puisant tous dans les passages majeurs du premier livre, Edwards livre enfin au public la scène du canot pneumatique du roman de Crichton, qui permettait déjà d’admirer les déplacements du T-rex dans l’eau : un élément que le réalisateur se plaît de toute évidence à exploiter dans le film, et qui présente ce mastodonte dans une situation encore jamais observée jusque-là. Après avoir vu son image sérieusement malmenée ou diminuée dans Jurassic Park III et Jurassic World, le T-Rex retrouve ses lettres de noblesse dans une séquence, certes pas entièrement réussie, mais qui permet enfin de revivre la terreur qu’il suscitait dans les premiers temps.
La photographie reste soignée durant une bonne première moitié du film, et tranche singulièrement avec ses prédécesseurs : plutôt que de laisser défiler des paysages dégueulant de CGI à toute vitesse, la caméra s’installe. Elle laisse à ses spectateurs quelques plans qui marquent, se permet de ralentir l’enchaînement des scènes en une combinaison moins précipitée. On pense aux très beaux plans mettant en valeur Mahershala Ali dans une aube rosée, filmé en contre-jour. Revenir à une forme de beauté pure et contemplative dans un Jurassic World avait de quoi, là encore, conforter le public dans l’espoir d’un retour aux sources bienvenu.
La vision d’Edwards vient également remettre quelques points sur les i côté personnages. Si la structure des Jurassic Park / Jurassic World reste cohérente avec un protagoniste obsédé par l’argent presque systématiquement présent, on trouve légèrement plus de nuance, notamment dans la manifestation de son attitude. Martin Krebs est un vrai salopard, qui s’assume dans toute sa splendeur sans forcément tomber dans le ridicule. Le film présente une scène de cruauté assez marquante pour souligner son tempérament sans scrupules, souligné par le jeu d’un Rupert Friend à la fois prédateur, vicieux et nonchalant. De manière générale, l’humour est aussi bien mieux dosé. Là où les Jurassic World laissaient la part belle à une beauferie sans limite (merci Chris Pratt), on retrouve ici quelques répliques qui font mouche sans en faire trop.
Côté cadre, les décors urbains comme ceux de la jungle semblent enfin plus naturels, ce qui est d’autant plus agréable qu’une bonne partie du long-métrage se déroule en plein jour : on est loin de la bouillie numérique, sombre et dégueulasse presque omniprésente sur une bonne partie de Fallen Kingdom comme pour Dominion. C’est également par ce biais que le réalisateur permet aux spectateurs de renouer, enfin (!), avec l’émerveillement qui avait tant saisi le public de Jurassic Park premier du nom. Au gré d’une parade d’accouplement, étrangement gracieuse malgré la masse des titanosaures, et dont l’esthétique s’inscrit durablement dans la lignée des œuvres d’Edwards, Rebirth, là encore, prend le temps de se poser. Il laisse à ses personnages l’occasion d’absorber et d’admirer la scène, pour créer une parenthèse simple, efficace, et tout simplement très belle. Ce moment, préféré à une énième péripétie d’action débile et forcée, et totalement inédit dans la saga, résonne avec une émotion authentique. Un choix audacieux, pour un film du genre, qui permet de reconnaître la sensibilité toute singulière de son créateur. Une scène parfaite pour, judicieusement, laisser flotter le thème musical de Jurassic Park.
Pour en revenir au casting à proprement parler, il s’agissait sans doute d’un des meilleurs points en faveur du film. Scarlett Johansson, Mahershala Ali et Rupert Friend forment une vraie combinaison gagnante. On peut également citer la présence d’Ed Skrein, que l’on prend toujours plaisir à retrouver sur grand écran. Davantage de scènes de conversation passent sans effort, livrant des échanges beaucoup moins artificiels que les dialogues épouvantables de Dominion, notamment. Concernant Zora (S. Johansson) et Duncan (M. Ali), c’est même carrément le sentiment de suivre un duo fait pour travailler ensemble, se connaissant de longue date et partageant des liens d’amitié sincères autant qu’un passé traumatique, vécu ensemble ou séparément. Les détails révélés sur leur parcours de mercenaires aident à les rendre plus sympathiques qu’au premier abord, mais surtout plus humains. Les acteurs se montrent plutôt généreux dans l’ensemble, bien que la palme d’or revienne sans doute à Ali, absolument toujours impeccable dans chacun des rôles de sa carrière. Pour Edwards, il n’est plus question que les protagonistes passent leur temps à se bastonner à grand renfort de piques nulles et prétendument “cool”. Les dialogues volent largement plus haut, et même la morale écologique est plus légère et moins sentencieuse que dans la première trilogie des Jurassic World.
Concernant le récit, là encore, le réalisateur rectifie le tir, en dispensant avec justesse des explications rationnelles et contextuelles sur le climat, et le pourquoi de cette nouvelle et dernière migration des dinosaures vers l’Équateur. Edwards donne le sentiment de vouloir mieux poser les choses, et de justifier avec plus de rigueur les éléments servant à ancrer le scénario de Rebirth. Personne n’avait réclamé des dinosaures se baladant dans le Montana si ce n’était pas pour en faire quelque chose d’intéressant. Il s’agit donc d’un retour aux sources judicieux, et qui ne pointe que d’autant mieux les énormités générées par Jurassic World ces dernières années.
Enfin, il dissémine intelligemment de nombreux hommages au monde du cinéma : qu’il s’agisse de Spielberg pour Les Dents de la Mer (dont le film vient de fêter ses cinquante ans), avec un superbe plan mâchoire annonçant la catastrophe à venir pour l’un des personnages, ou de clins d’œil agréables ; on peut mentionner le fameux rétroviseur, le bus floqué Crichton School en référence à l’auteur des romans, la recherche frénétique de l’accès aux docks rappelant la fuite de Dennis Nedry, etc. Autant de points qui permettent à Rebirth de s’inscrire dans la lignée de la franchise, sans devenir prétexte à une énième vente de goodies ou à un effet artificiel imbuvable.
D’autres hommages pertinents ont de quoi satisfaire les aficionados des films d’aventure de bout en bout. En effet, il est impossible de ne pas songer au King Kong de Peter Jackson. L’exposition qui se déroule sans se presser, l’arrivée d’une équipe en bateau sur une île désertée par l’humanité et remplie de “monstres” hostiles, le débarquement complètement chaotique et qui vire à la catastrophe quasi complète, et le mélange de préparation et d’amateurisme complet parmi les personnages : tous ces éléments évoquent forcément l’un des meilleurs films d’aventure des années 2000. Edwards ne se prive d’ailleurs pas pour rendre Rebirth moins impersonnel, glissant çà et là des références à l’univers de Godzilla, tant par un extrait vu à la télévision que par l’introduction même, qui rappelle celle de son Godzilla de 2014.
Pourquoi est-ce qu’on dit non ?
À ce stade de la lecture, vous vous dites sûrement que tout ça se présentait quand même vachement bien. C’était sans compter l’incompréhensible effondrement d’un film qui avait tout pour proposer enfin quelque chose de mieux, et un vrai nouveau départ pour une saga déjà à bout de souffle.
Plus vite qu’il n’en a l’air, Rebirth montre des signes de fragilité structurelle évidente. Le scénario et le montage auraient pu tenir la route, si des travers largement évitables, inadmissibles de la part d’un réalisateur confirmé et connu pour sa capacité à puiser dans l’essence d’un blockbuster, n’apparaissaient pas dès la moitié du long-métrage. Au lieu de garder un fil rouge précis, de faire foisonner une intrigue au potentiel infini comme il le fit avec talent pour Star Wars : Rogue One, les fautes s’enchaînent. Quelques scènes sibyllines n’aboutissent à rien, et la qualité de leur photographie n’empêche pas le spectateur de sortir du film en s’interrogeant à leur propos, plutôt que de profiter d’une immersion totale. Comme du vernis qui s’écaille, le constat est implacable : Rebirth paraît vouloir se distinguer de ses prédécesseurs, sans succès. Il devient confus, cherche à imbriquer l’ancien avec le nouveau, le logo historique de Jurassic Park avec une police d’écriture neutre et plate au possible plutôt que de jouer avec les vrais codes de la franchise. Et en parlant d’impersonnel, c’est l’occasion de rappeler qu’une fois de plus, depuis la défection de John Williams à la musique, les compositions des Jurassic World sont à pleurer de fadeur. Terminé les thèmes magistraux composés par le créateur historique d’une symphonie connue dans le monde entier. Alexandre Desplat succède à Michael Giacchino (pourtant tous deux largement à la hauteur), pour pondre une bande originale que l’on pourrait davantage qualifier de “bruit de fond”. Hormis deux ou trois morceaux accompagnant très bien l’action ou l’émotion, les pistes s’enchaînent indistinctement, sans accorder de valeur ajoutée à quoi que ce soit. Une malédiction qui dure maintenant depuis cinq films, comme si l’ombre de Williams avait de quoi trop impressionner ses successeurs pour leur permettre de livrer une performance digne de ce nom. À moins que la piètre qualité des œuvres ne puisse leur inspirer autre chose que ces bandes originales dépourvues de charme ou d’empreinte tangible.
Pire encore, comme si tous les grands réalisateurs du monde s’étaient passé le mot pour donner dans la surenchère médiocre (car oui, Steven Spielberg fait bien partie des producteurs délégués du film), tous les grands monstres de la pop culture d’aventure et d’horreur semblent promis, eux aussi à une hybridation permanente entre eux, quand ils ne sont pas tout bonnement saccagés (coucou Alien Covenant). Vous en aviez assez de la déferlante de cinquante dinosaures à la minute dans les Jurassic World ? On vous présente le D-Rex (oui…), version mutante du T-Rex, et dont la gueule vous évoquera forcément une reine Alien. Si la trahison envers les premiers opus de Jurassic Park s’était déjà installée depuis longtemps, Rebirth plante donc ici le dernier clou du cercueil plus sûrement encore que Jurassic World, Fallen Kingdom et Dominion.
Avec le dégoût d’une énième mascarade ruinant un univers de base prodigieux d’intelligence et de potentiel, c’est même l’ennui qui couronne le tout ; un défaut inacceptable pour le visionnage d’un Jurassic Park. On en vient à prier pour que le supplice prenne fin le plus rapidement possible, tout en songeant aux 11€50 d’une place de cinéma, aux bonnes vieilles répliques de Jeff Goldblum, et à la mise en scène grandiose des premières attaques de T-Rex et de raptors de 1993 qui ont traumatisé tous les gamins de l’époque.
Et quand les effets spéciaux paraissent enfin à la hauteur, c’est finalement le retour à cette fameuse bouillie numérique dans le noir dont on se voit gratifié pour une conclusion à la limite du guignolesque, tant elle se montre à la fois improbable, grotesque et convenue. De plus, après avoir milité pour un retour à l’essentiel, Edwards cède finalement au marketing débile qui émaille tous les blockbusters de l’époque, à savoir : l’introduction de petits personnages mignons pour séduire un public juvénile qui, quant à lui, ne risque pas d’être traumatisé par grand-chose dans ce film.
Comme si le film se scindait en deux, sa seconde moitié consacre les personnages dans des positions de plus en plus archétypales. Le fil moral élastique de certains d’entre eux est assez instable. En guise d’énième clin d’œil, Edwards nous ressert le coup de l’argent, qui reste le moteur de base des protagonistes. Destiné à nous rappeler tous ceux qui, bien avant Rebirth, sont tombés dans le panneau (Alan, Ellie, Nick, Billy, Claire…), il n’était pas très intéressant de provoquer une redite aussi grossière. Le développement de leurs motivations comme de leurs décisions s’effrite d’autant plus, et pèche par manque de crédibilité : le gentil paléontologue qui convainc la mercenaire vénale de renoncer au paquet de fric capable de la mettre à l’abri jusqu’à la fin de ses jours, la famille assez débile pour aller se payer une croisière dans des eaux abritant un mosasaure connu pour sa dangerosité, des crises de conscience qui tombent aussi subtilement qu’un piano du huitième étage, etc. On nous promettait autre chose que des coquilles vides ? Edwards n’aura malheureusement pas tenu longtemps, renversant ses bonnes résolutions en limitant finalement au strict minimum les détails capables de donner de la chair à ses personnages. On en viendrait presque à pardonner à Jonathan Bailey son jeu d’acteur qui confine au cabotinage in-su-pportable, incarnant un protagoniste aux répliques faciles et à la niaiserie gonflante. Les “civils” de Rebirth ne valent pas beaucoup mieux, servant davantage de prétextes à faire traîner les péripéties et l’histoire qu’à apporter quoi que ce soit de satisfaisant par leur présence. Quant au père de famille, on en vient presque à se demander pourquoi ils n’ont pas embauché Pedro Pascal (oui, c’est un tacle gratuit, oui, je sature un peu de la Pedro-Mania, et oui, je suis heureuse qu’ils ne l’aient pas fait), étant donné la transparence de son caractère se limitant à : père de famille latino un peu grognon sur les bords, mais finalement gentil.
Le manque de crédibilité global a d’ailleurs malheureusement fait son entrée dès les premières minutes de l’introduction. Sachez qu’une faille de sécurité chez InGen (oui, oui : InGen, hein, ceux qui sont assez balèzes pour recréer des dinosaures, voire des mutants, voire des sur-sur-mutants) peut être provoquée à cause d’un emballage de Snickers aspiré dans le conduit d’une porte automatique. Vous trouvez ça con ? Rassurez-vous, c’est normal. On est loin d’une brèche de réacteur nucléaire dans Godzilla. L’évocation se transforme ainsi rapidement en mascarade. InGen a beau ne pas briller par sa morale ni par sa lucidité permanente, car plusieurs incidents ont déjà émaillé leurs infrastructures, mais… un emballage de Snickers ? Plus je l’écris, plus je trouve ça abyssalement con. Sans compter l’établissement d’une énième île dans le lore déjà bien chargé de Jurassic Park / World. Si Le Monde Perdu choisissait intelligemment de présenter le fameux site B sur Isla Sorna, plutôt que de demeurer dans le premier parc ancré à Isla Nublar, ici, Rebirth joue la carte de la surenchère, revenant sur le pacte tissé implicitement avec son public : toujours plus de dinosaures, toujours plus d’action stupide, toujours plus d’îles cachées. Ça commence à faire un peu beaucoup là, non ? Car s’il m’en coûte d’écrire ce constat un peu paradoxal, c’est pourtant bien la vérité : le film montre TROP de dinosaures. Pour rappel, Jurassic Park avait bouleversé le monde entier en cumulant uniquement quinze minutes de scènes comportant les reptiles géants. Quinze minutes soigneusement choisies, disposées, générant une ambiance lourde et angoissante à souhait, et qui faisait mouche systématiquement. Depuis Jurassic Park III, un tournant évident a précipité la franchise dans une accumulation sans queue ni tête de bestioles à plus ou moins grandes dents. Pas le temps de respirer : il ne faudrait pas que le public d’abrutis qui n’ont pas envie de se prendre la tête s’ennuie. METTEZ. ABSOLUMENT. TOUT. Du vrai dinosaure, du dinosaure mutant, des dinosaures qui tirent des sabres lasers avec le cul tant qu’on y est, pourquoi pas ? (Ne rigolez pas, on n’en était franchement pas loin avec ces conneries de Fallen Kingdom et Dominion.) Eh bien dommage : on s’ennuie quand même. Ça valait bien la peine, tiens.
David Koepp se fourvoie ainsi pour la troisième fois en continuant de se montrer inégal : après le scénario clair et presque parfait de Jurassic Park et celui, plus étrange et dysfonctionnel, du Monde Perdu, son choix de présenter une énième entreprise pharmaceutique véreuse en guise d’antagoniste n’était pas forcément très inspiré. Rejouer le coup d’une expédition tout juste préparée non plus. Quant aux hommages qui émaillent le film : si ceux cités précédemment restent de bonne qualité, d’autres finissent eux aussi par polluer le récit, continuant de gangréner la saga jusqu’à l’écœurement. Même la fameuse banderole, si caractéristique, en devient navrante et surannée, au moins autant que le thème musical de John Williams utilisé à outrance. On en vient d’ailleurs à se demander pourquoi notre époque est aussi obsédée par les hommages référant aux films compris entre les années 80 et 2000. Comme si, au lieu de continuer à avancer et à créer des référentiels nouveaux et marquants pour toute une ère cinématographique, celle des années 2010 continue, depuis quinze ans, de tisser une sorte de bilan en nageant dans la nostalgie neuneu d’un public lassé, mais malléable quand même. Plutôt que de travailler sur l’intensité dramatique de son histoire et sa portée émotionnelle, Rebirth se contente de faire une fois de plus du prémâché : les gentils survivent, les méchants sont punis, les enfants continuent de sauver la mise systématiquement, et on serait bien en peine de trouver quelque chose de profond à analyser là-dedans.
Comme un calque interminable et usé jusqu’à la corde, on retrouve des scènes d’action poussives, de cache-cache dans le noir cherchant à réutiliser les codes de la scène de la cuisine de Jurassic Park sans jamais pouvoir lui arriver à la cheville. On s’emmerde, on regarde l’heure, on prie pour que le calvaire prenne fin. Les grands filmeurs d’aujourd’hui ne savent plus créer d’atmosphères horrifiques tangibles : ni via la musique (insipide), ni par l’utilisation du silence. Ce copié collé, devenu intolérable, des films d’action où la fin arbore une traque dans l’obscurité afin de cacher les effets spéciaux moisis, perdure depuis plus de quinze ans maintenant, et donne sérieusement à interroger sur la créativité en berne à Hollywood. Trop long, trop poussif, Rebirth retombe finalement dans les travers des opus précédents. Aucune mort marquante ne vient donner un sens aux actions des personnages. On est loin du sacrifice de Malcolm, prêt à mourir pour permettre à Alan Grant de sauver les enfants. On est loin du sacrifice d’Eddie donnant sa vie pour Ian, Sarah et Nick. Et plus loin encore du sacrifice de Billy, cherchant sa rédemption dans une mort atroce pour offrir une échappatoire à son mentor et ami. Les Jurassic World ne tuent plus leurs personnages (hormis les protagonistes dont on se fout complètement, évidemment), ce qui est un problème à lui seul : les enjeux en deviennent dérisoires, et la valeur des uns et des autres, réduites à des T-Rex ex-machina, raptor ex-machina, cucul ex-machina. Ce manque de courage de la part des réalisateurs successifs et de leurs producteurs associés est l’un des poids qui plombent durablement la pertinence de ces suites de films, dont aucun ne parvient à toucher comme les premiers ont réussi à le faire. Gareth Edwards admirait le King Kong de Peter Jackson ? Il aurait mieux fait de le prendre pour exemple jusqu’au bout.
Le verdict est clair. Vous ne retrouverez pas la magie du premier Jurassic Park. Le vieux rêve de Spielberg, à l’image de celui de John Hammond, est mort et enterré depuis longtemps. En revanche, vous pourrez bientôt retrouver sur le site de l’Écran une chronique en deux parties sur la grandeur et la décadence de la franchise.
Et surtout, n’oubliez pas, même au cœur de l’été : n’allez pas dans les hautes herbes.