C’est l’histoire d’un raté comme on en connaît des dizaines dans le monde du cinéma. Certains de ces échecs restent cependant plus facilement acceptables que d’autres, et ce n’est pas le cas du film L’Ombre et la Proie (The Ghost and the Darkness) de Stephen Hopkins. Sorti en 1996 avec Val Kilmer et Michael Douglas dans les rôles-titres, il met en scène la catastrophe impliquant deux lions du Tsavo en Afrique, responsable de la mort de plus d’une centaine d’ouvriers sur un chantier ferroviaire. Tiré d’une authentique histoire vraie, le long-métrage possédait toutes les qualités d’un grand divertissement d’aventures, à la hauteur de ses prédécesseurs. Dans cette deuxième moitié des années 90, Hollywood avait comme su capter les ingrédients miracles et indispensables à la recette d’un beau succès populaire (Le Dernier des Mohicans, Waterworld, Braveheart ou encore Jurassic Park, pour ne citer qu’eux). Il faut souligner les ambitions initiales d’une équipe de production qui se voyait déjà donner naissance à la parfaite symbiose entre Lawrence d’Arabie et Les Dents de la mer, bien avant la sortie du très décrié Beast en 2022.
Après la première rétrospective sur Jaws et son requin tueur, c’est au tour de L’Ombre et la Proie : les raisons de l’échec ou comment le récit d’une tragédie épique aurait pu devenir un film culte.
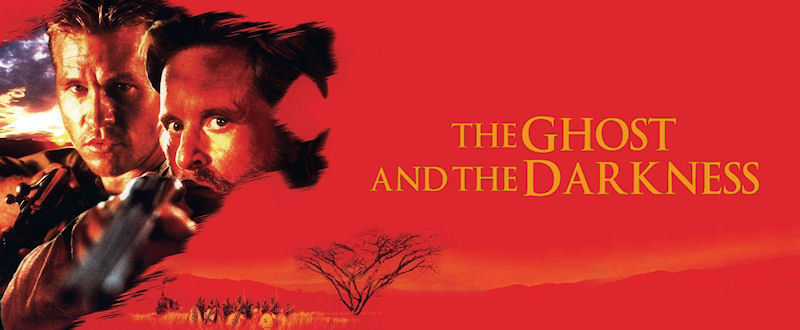
I. CE QUI MARCHE
1. Une galerie de personnages variés, portés par une distribution engagée
Le casting est souvent l’un des gages de réussite d’un film abouti. Même un scénario passionnant ne résiste pas à l’apathie de ses comédiens ou à une direction d’acteur inadéquate. Ce n’est définitivement pas là que le bât blesse pour L’Ombre et la Proie. Val Kilmer (The Doors, Heat) incarne le colonel John Henry Patterson, ingénieur britannique de renom engagé pour la construction d’un pont au-dessus de la rivière Tsavo, et dont le chantier sera attaqué sans relâche. Humain, bienveillant et passionné par l’Afrique (à l’image de son interprète), le personnage se dépeint comme un héros aux contours plutôt traditionnels, mais peu inintéressants pour autant. Son évolution semble effective tout du long, tant son flegme britannique initial se voit peu à peu poussé à bout et transformé en une rage presque incontrôlée, le tout géré à la perfection par Kilmer. Porté par la force tranquille qui habite Patterson, on serait pourtant mal avisé de croire son jeu faible ou fade. La ténacité et l’acharnement dont il fait preuve face aux attaques incessantes de deux lions considérés crescendo comme des émanations surnaturelles nouent indéniablement la sympathie du spectateur à son égard. Humilité et talent, raison et bravoure, loyauté et détermination sont parfaitement intégrées dans l’ADN du personnage : difficile alors de ne pas s’attacher à l’un des piliers du film, apparaissant tel l’un des rares espoirs de mettre fin au carnage.

©Paramount Pictures
Pour ce qui est des autres, on ne demeure pas en reste : John Kani (Captain America : Civil War, Black Panther) campe Samuel, sorte de référent et porte-parole des travailleurs locaux se posant en narrateur du film, à la fois sage, réfléchi, mais pas dénué de quelques saillies humoristiques bienvenues. L’effet-miroir est d’autant plus agréable comparé au jeu d’Om Puri (Gandhi, Wolf) dans le rôle d’Abdullah, représentant pour sa part les ouvriers indiens et pakistanais. Plus sombre, plus vindicatif à l’égard des Britanniques, il souligne à lui seul l’enjeu des vies humaines perdues au fil des mois sur le chantier et la révolte qui ne cesse de couver à l’encontre de Patterson. Bernard Hill (Le Seigneur des Anneaux, Titanic) est LA bonne surprise du film, en interprétant le médecin Hawthorne, acide, fiable et nihiliste, responsable de l’infirmerie du camp et donc témoin direct des conséquences des attaques répétées. Quant à Angus Starling, sous l’égide du méconnu Brian McCardie, ses élans de prédicateur désireux de convertir tout païen à portée de main vient ajouter un peu de son fanatisme séduisant et surtout intrigant au panel de figures déjà citées.
Les rôles plus secondaires ont eux aussi droit à des comédiens impliqué : Tom Wilkinson (L’Exorcisme d’Emily Rose, Batman Begins), en supérieur de Patterson, se lâche dans la peau d’un véritable salaud intégral, dont le manque de nuances reste cependant assez raccord avec certaines postures coloniales récurrentes au cours du XIXe siècle. Unique actrice du casting, Emily Mortimer (Shutter Island, La Panthère rose) incarne quant à elle Helena Patterson pour son premier rôle dans un long-métrage. Si son jeu peut paraître plus maladroit et caricatural, la fraîcheur lumineuse du personnage suffit largement à ce qu’on le lui pardonne. Enfin, il faut mentionner la brève interprétation d’Henry Cele, dont les traits singuliers et le timbre grave apportent un magnétisme remarquable au personnage de Mahina, ouvrier charismatique ayant par le passé tué à lui tout seul un lion à mains nues.
2. Une bande originale grandiose
On ne présente plus Jerry Goldsmith, compositeur reconnu à Hollywood et toujours capable de se réinventer jusqu’à son décès en 2004. D’inspiration kaléidoscopique, plusieurs générations de films ont bénéficié, sous sa houlette, d’une bande-son puissante et exaltée (La Planète des Singes de 1968, The Omen, le Mulan de 1998, La Momie, etc.). C’est à lui qu’est revenue la tâche d’illustrer musicalement ces pérégrinations africaines, et force est de constater que l’artiste s’est bien montré à la hauteur du défi. Il faut rappeler que les films d’aventures des années 90 se sont souvent pointés comme indissociables de partitions tutoyant un souffle épique nécessaire pour porter l’action à l’écran. Là encore, Le Dernier des Mohicans n’est qu’un des nombreux exemples possibles parmi tant d’autres de la tendance de l’époque et les notes de Trevor Jones sont bien souvent plus vivaces à l’esprit du grand public que les images du film lui-même.
Sur cette lignée, Goldsmith n’a pas lésiné sur les procédés et a investi à son tour des moyens pertinents, efficaces pour donner toute la puissance légitime au scénario. Très marqué par des chants africains et indiens rendant hommage à la composition multiculturelle des ouvriers du chantier ferroviaire, il passe habilement d’un registre à l’autre, évitant de tomber dans le piège d’une bande-son trop linéaire ou monotone. Si l’on peut reprocher une légère faiblesse dans le traitement de la joie, du romantisme ou de l’euphorie, il n’en est rien quant à l’expression de la noirceur, de l’inquiétante étrangeté des deux lions et de l’aspect mystique, combatif et désespéré de l’histoire de L’Ombre et la Proie. Goldsmith livre des morceaux stupéfiants de profondeur, et sait rendre hommage aux scènes les plus emblématiques du film.
3. Une immersion prenante et hypnotique
La mise en scène est largement inspirée des deux chefs-d’œuvre dont elle souhaite se revendiquer. Pour Les Dents de la Mer, en guise d’océan, c’est la savane en herbe ondulant au gré du vent ou au calme de façade depuis laquelle on prévoit l’émergence d’un prédateur. L’effet très réussi s’ajoute à celui de l’attente : il faut du temps avant de voir apparaître l’un des deux fauves, et l’une des premières attaques révélées emprunte beaucoup à la première victime du squale. Enfin, un parallèle évident avec un lion tué au début du film et le requin-tigre que beaucoup croient responsable des offensives précédentes complète l’hommage. Quant à Lawrence d’Arabie, difficile de ne pas tisser des liens flagrants avec Patterson : son enthousiasme de héros romantique, son calme et son astuce, sa passion pour le continent africain sont autant de clins d’œil rappelant instantanément Thomas Edward Lawrence.
De manière plus globale, la mise en scène fascine par sa volonté de tanguer entre mysticisme, réalisme, fable et adaptation d’une histoire vraie. Si certains ont pu être déroutés par cette absence de véritable parti pris, le choix fonctionne dans sa façon d’attirer son spectateur au cœur de la région kényane. L’immersion est totale, et l’objectif essentiel du film accompli : nous sommes en Afrique pendant deux heures et aucune fausse note ne semble à priori capable de nous tirer hors de cet univers-là. L’atmosphère travaillée n’est pas davantage trahie par l’apparition des deux prédateurs. La gestion des lions est d’autant plus impressionnante quand on pense qu’une seule scène utilise le recours aux trucages animatroniques pendant tout le film.

©Paramount Pictures
Quelques plans notamment sublimés par une caméra amoureuse de la faune et la flore locale finissent de nous entraîner dans le sillage de l’aventure : rendant plus facile le passage de l’émerveillement à l’angoisse de voir le chantier prit pour cible par les fauves, jusqu’au désenchantement d’un cadre devenu particulièrement hostile.
II. CE QUI FOIRE
1. Michael Douglas
N’est pas Quint qui veut. Dans la lignée des hommages aux Dents de la mer, le personnage de Charles Remington, créé spécialement pour le film, avait tout du baroudeur expert de la traque au lion, venu tenter de sauver le chantier tant qu’il en est encore temps. Si le lien avec le chasseur de requins survivant de l’Indianapolis et habité par son désir de vengeance est évident, la réussite de l’interprétation du protagoniste l’est beaucoup moins. En tous points conquis par l’intrigue lors de sa préproduction, Michael Douglas (Wall Street, Basic Instinct) décide aussitôt de coproduire L’Ombre et la Proie, tout en accaparant le rôle de Remington. L’acteur paraît à l’évidence à l’origine d’une bonne partie des défauts du film. Outre une tension croissante entre Stephen Hopkins et William Goldman (respectivement réalisateur et scénariste) en imposant ses désidératas, difficile de ne pas grimacer devant le jeu de Michael Douglas. La roublardise, le sale caractère et le tempérament réservé et bourru de Quint semblent bien loin. Remington apparaît plutôt comme un personnage accumulant les clichés dont on se passerait bien, des poses frisant le ridicule et des répliques sonnant toutes plus creux que jamais dans la bouche d’un Douglas décidément peu avisé. L’acteur paraît plus concerné par le trope du chasseur revêche que par l’envie d’incarner dans les règles de l’art un protagoniste accrocheur et captivant. Son arrivée aurait dû donner une bouffée d’air frais pour l’histoire du film et pour nous autres spectateurs. À la place, le mouvement et l’action semblent plombés par un jeu plat et insipide, inspirant tout sauf l’empathie et l’intérêt pour celui qui aurait dû bénéficier d’un attachement significatif.

©Paramount Pictures
C’est sans compter les décisions prises sous la casquette de producteur. De nombreuses rumeurs considérées comme sérieuses autour du film évoquent notamment l’ego de Michael Douglas et son conflit avec Hopkins. Quarante-cinq minutes de film auraient ainsi été supprimées au montage afin d’ajouter davantage de scènes impliquant Charles Remington. Le résultat ? Des passages parfois comme insérés là à la va-vite, et un effet régulier de « téléfilm » très désagréable, allant totalement à l’encontre du projet initial. La sensation de gâchis n’en est que plus forte, quand on pense à tous les éléments rassemblés, une autre issue pouvait être possible que celle proposée au public durant l’été 1996.
2.Un traitement des personnages trop superficiel…
Si les personnages de L’Ombre et la Proie sont bien assez intrigants ou intéressants pour les spectateurs, c’est sans compter les conséquences immédiates de ces problèmes de montage évoqués juste ci-dessus. Pas assez exploités, les protagonistes en deviennent rapidement cantonnés à des contours étriqués et plutôt frustrants. Val Kilmer s’en sort le mieux, bien qu’on aurait sans doute préféré un développement plus accompli de son arc, une meilleure expression de ses doutes et dilemmes, voire pourquoi pas un retour sur les origines irlandaises de Patterson. Bernard Hill aurait mérité bien plus de scènes à l’écran, pouvant par exemple justifier de l’amertume permanente d’un médecin engagé auprès de ses patients tout en cultivant une sorte de méfiance naturelle envers ses propres compatriotes britanniques. La backstory du Docteur Hawthorne aurait eu largement de quoi renforcer la crédibilité et le parti pris original de ces figures multiples. Angus Starling, avec sa manie de vouloir convertir à tour de bras, disposait lui aussi d’un potentiel qu’on aurait souhaité voir exploité à son maximum. Les rares débats et discussions entre les hommes rassemblés le soir autour d’un feu de camp sont assez captivants pour qu’on puisse regretter de s’en tenir à quelques saillies vite oubliées.
Certaines scènes manquent de temps pour exposer correctement leur problématique. En somme, c’est tout le film qui pâtit du montage remodelé de façon inégale. Parfois trop longues, parfois trop courtes, plusieurs parties du long-métrage trahissent un défaut d’équilibre qui a sans doute dû jouer en sa défaveur auprès des critiques. Il est largement possible d’imaginer que la non-intervention de Michael Douglas aurait pu donner un résultat de bout en bout différent. Hopkins et Goldman, habités par le scénario et le potentiel du projet, révèlent à eux seuls la volonté authentique de porter un grand film à l’écran, à l’égal de leurs modèles déjà évoqués. Néanmoins, on est loin du souffle intemporel de Lawrence d’Arabie, tout comme du rythme géré à merveille de l’arc narratif des Dents de la Mer.

3. … et des thèmes majeurs laissés en plan
Le contexte du film est l’occasion de rappeler l’importance capitale des enjeux ayant cours. À la fin du XIXe siècle, le partage de l’Afrique s’effectue entre trois des plus grandes puissances économiques et coloniales du monde : la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Nous devons à cette course à l’exploration le dessin des frontières des États africains d’aujourd’hui (les Français ayant privilégié un axe ouest-est, et les Anglais nord-sud). À plusieurs reprises, la guerre a failli éclater entre les deux nations, et l’occupation des territoires, ainsi que la manière d’acheminer les ressources et les hommes, était à l’esprit de tous les gros décideurs de l’époque. Le pont de Tsavo et son importance capitale sont très bien retranscrits dans le long-métrage, mais de nombreux autres thèmes ne sont que survolés, là où ils auraient mérité un développement très profitable à la cohérence et au réalisme du film, sans rien lui ôter côté divertissement. Le conflit entre les ouvriers indo-pakistanais et africains reste cantonné à une séparation de rigueur et quelques mauvais regards. Les effets du colonialisme et la façon de vouloir forcer la conversion des « indigènes » comme de les mépriser manquent là aussi d’approfondissement. S’il est appréciable de ne pas voir Hopkins tomber dans le manichéisme en soulignant au contraire la bienveillance de certains Britanniques présents sur place, il aurait été tout de même intéressant d’exploiter cet aspect peu reluisant de l’époque, accentuant le sentiment d’injustice des travailleurs terrorisés.
Même l’arrivée de la célèbre tribu maasaï dispose d’un traitement limité. Leur présence renforce l’inquiétude suscitée par les lions et baptisant le film (The Ghost and The Darkness, traduction des noms donnés par les Maasaï aux créatures qu’ils soupçonnent plutôt d’être des mauvais esprits). Leur réputation de grand chasseur et leur propre peur face aux bêtes meurtrières ne sont utilisées que brièvement, laissant un goût d’inachevé et de superficialité décidément bien tenace.
III. POURQUOI Ç’AURAIT PU ÊTRE GÉNIAL ? — LA RÉALITÉ DERRIÈRE LA FICTION
1. Parce que l’histoire est à peine croyable, et pourtant vraie
Il est difficile d’imaginer plus fascinant comme récit, et tout était fait pour qu’Hollywood s’en empare tôt ou tard : une course contre la montre aux dimensions internationales, deux lions mâles chassant ensemble et au comportement de prédateur hors du commun, un héros britannique aux origines irlandaises doté de bravoure et de persévérance, un nombre de morts hallucinant… Tsavo, c’est l’histoire d’une région toujours bel et bien hantée par ce souvenir comptant plus de cent-quarante victimes selon certains dires (les archives officielles s’attachant à évoquer « une trentaine » de manœuvres décédés). L’arrivée de John Patterson sur le chantier a aussitôt précédé les premières attaques, conférant dès le départ un aspect mystique et romanesque à la tragédie. Les conditions de vie des ouvriers, rapidement mises en péril dès lors qu’ils s’aventurent un peu trop loin de leur tente, dévoilent le comportement répété et inquiétant d’animaux ne chassant plus seulement pour se nourrir, mais bien par appétit du sang. On pense illico aux travaux d’un certain Kipling et de son Livre de la Jungle, mais ici la fable n’a pas lieu d’être, et les tueries se sont multipliées pendant à peu près neuf mois. Cette longévité de la catastrophe n’est pas mal abordée par le film, mais aurait elle aussi mérité une exposition plus importante, marquée par des jalons temporels significatifs et permettant d’en prendre toute la pleine mesure.

L’aspect surnaturel des deux fauves est au cœur du mystère, au point d’inspirer Goldman lui-même : « Mon sentiment particulier est qu’ils étaient le Mal. […] Je crois que durant ces neuf mois que durèrent les attaques, le Mal était tout bonnement sorti des entrailles du Tsavo. » La persévérance des lions, mais également leur capacité à surmonter tous les pièges instaurés pour les capturer ou pour les repousser, aurait eu de quoi impressionner le chasseur le plus aguerri. Si Charles Remington lui-même est mis en difficulté face à des ennemis pareils, à l’image d’un Quint luttant contre un requin retors et vicieux, on en vient tout de même à regretter l’existence du personnage, saccageant l’effet de duel par le jeu de Douglas. En réalité, John Patterson est parvenu seul à abattre « Ghost » et « Darkness », et Val Kilmer aurait presque pu incarner alors à l’unique adversaire des deux créatures. Pour couronner le tout, Patterson a dû, en plus de la situation déjà inextricable, déjouer un complot imaginé par certains des ouvriers indiens, persuadés que l’ingénieur britannique était le responsable de ce qui ressemblait fort à une malédiction. Voir les hommes se déchirer entre eux au point de chercher à s’entretuer aurait été une nuance de plus à apporter au film. Si les face-à-face entre John et Abdullah accordent une certaine tension narrative appréciable, un plus ample développement des personnages aurait, là encore, pu donner une dimension plus profonde à l’opposition entre les uns et les autres.

©Librededroit
2.Quid des lions ?
La violence excessive des deux lions a longtemps interrogé la communauté scientifique, jusqu’à tout récemment. La découverte à l’époque de leur tanière ainsi que d’un nombre impressionnant d’ossements attestant de leur régime alimentaire (incluant en particulier des hommes) n’avait pu que renforcer l’effroi suscité par leur agressivité à l’égard des ouvriers du chantier. Une étude de 2017 a pu apporter quelques potentiels éléments de réponse. La raréfaction des gibiers, l’épidémie de peste bovine ayant mis à mal les troupeaux et la sécheresse peuvent expliquer l’intérêt des fauves pour les humains, alors en quantité suffisante pour satisfaire leurs besoins en nourriture. L’analyse attentive de la dentition de l’un des deux a pu révéler la présence d’un abcès particulièrement douloureux, ce qui a pu pousser l’animal à se tourner vers des proies moins rapides que celles habituellement traquées. Une justification peut-être rationnelle, mais pas moins incroyable, d’autant lorsqu’on pense à son comparse, chassant à ses côtés comme mus par une forme de « solidarité » surprenante, mais pas inédite dans le monde sauvage.
Pour l’heure, le mystère subsiste en partie, et a fasciné certains des plus grands de la société de l’époque, allant des membres du Parlement britannique jusqu’au président américain Roosevelt lui-même. Celui-ci a réclamé que la dépouille des lions soit reconstituée et exposée à Chicago. Ils demeurent encore visibles, à ce jour.
Si aucune rumeur concernant un quelconque remake n’a agité la toile, il est possible qu’un tel projet puisse refaire surface, tant le récit est incroyable en lui-même. Bien que probablement enjolivé au profit de Patterson, il n’empêche pas que le fait divers soit suffisamment mémorable pour nous faire espérer, un jour, une nouvelle version bien plus ambitieuse que ne l’était l’originale.
The Ghost & the Darkness avait tout pour devenir un très grand film des années 90. Si ses failles sont malheureusement trop béantes pour le qualifier de long-métrage de qualité, il n’en reste pas moins que les images ont remarquablement bien vieilli, et qu’il n’est pas si difficile de mettre de côté les défauts de l’œuvre de Hopkins. La bande-son de Jerry Goldsmith, une atmosphère prenante et un ensemble dépaysant suffisent à convaincre pour se laisser embarquer pendant deux heures, et à profiter avec plaisir d’un très honnête divertissement.

