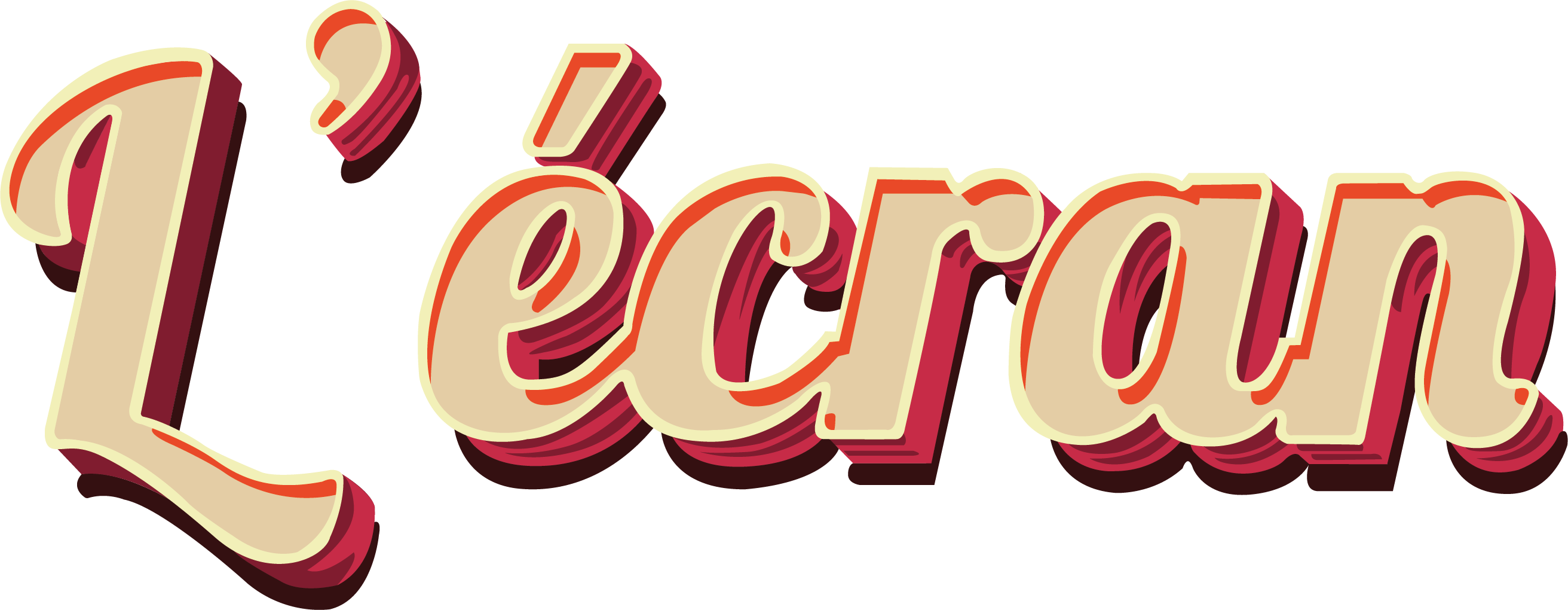Un ami avait, fortement à propos, parlé du Fifigrot en ces termes : “C’est un croisement entre un film des frères Coen et l’Internationale”. Du politisé, mais potache, de l’absurde, mais avec du fond, c’est ce qu’on vient chercher chaque année dans ces contrées Grolandaises. Nous avons eu le plaisir et l’honneur de pouvoir participer une année de plus au festival, et voici un compte rendu des coups de cœur — mais pas que — de ce festival qu’il est bien.
Lendi 15 Septemb’
Début de festival pluvieux, début de festival heureux : pour changer, j’ai décidé de commencer mon Fifigrot 2025 non dans une salle de cinéma, mais au milieu du public sautillant au Gro’Village devant le concert de Funky Style Brass. Public encapuchonné, emmitouflé, en kwayé pour échapper aux gouttes qui décident ÉVIDEMMENT de choisir le meilleur moment pour se pointer. Heureusement, elles n’entachent en rien ce début de festival enthousiaste au Gro’Village. Un vrai plaisir de déambuler parmi les livres de la librairie, de regarder l’exposition de d’El Batia Moûrt Soû, ou de jouer au morpion… avec des balles et des boîtes d’œufs, si, si c’est possible ! Quant au concert, on ne peut pas dire que ce soit mon style de prédilection, moi qui préfère les métalleux sinistres aux envolées trompettueuses de Funky Style Brass… J’ai pourtant passé un excellent moment en leur compagnie. Leurs costumes pailletés et colorés particulièrement kitsch ont fait un bien fou à cette journée de grisaille, et je vous invite à découvrir ce groupe avec plaisir !
Mordi 16 Septemb’
Baise-en-ville – Spleen uberisé
De Martin Jauvat
Avec Martin Jauvat, Emmanuelle Bercot, William Lebghil
Première séance du festival avec Baise-en-ville, et là, cher-es lecteurices, il faut que l’on parle : suis-je la seule de cette planète à découvrir que cette expression désigne une sacoche au format particulier et au dessein… Plus qu’explicite ? Heureusement que Martin Jauvat s’est chargé de faire mon éducation ! Dans Baise-en-ville donc, nous suivons les tribulations de Corentin Perrier qui tente de passer son permis. C’est tout. Oui, mais… Ce récit simple est prétexte à broder autour de péripéties improbables à base de start-ups foireuses, de personnages névrosés qui font des clefs de bras au milieu de la route, de bonde de douche qui devient une évasion philosophique ; car c’était la technique de réflexion privilégiée d’Einstein après tout. Raconté comme ça, on dirait du grand n’importe quoi, et cependant derrière cette comédie absurde et potache se cache un récit de fond sincère et terriblement juste. Corentin Perrier traverse une crise de la fin de vingtaine, perdu dans une dépression latente, une quête de sens, une époque qu’il n’aime pas, des galères, des crises de cœur et une solitude profonde. Je mets au défi n’importe quel millénial de ne pas se reconnaître dans ce personnage un peu loser, mais profondément attachant, reflet du déclassement social que vit notre génération. Baise-en-ville c’est enfin un film bourré d’espoir. La mise en scène colorée était volontairement un peu criarde selon Martin Jauvat afin de “réenchanter le quotidien”, ramener de la poésie dans le paysage le plus banal possible. Il n’a pas été sans nous rappeler le mouvement de la banalyse, conférence à laquelle j’avais assisté dans le cadre d’une précédente édition du Fifigrot. Il est rare de voir un regard aussi doux et bienveillant porté sur les banlieues pavillonnaires. Ce film montre que même dans ce contexte difficile et un quotidien parfois morose, il est possible de trouver son bonheur et sa place même si elle consiste à nettoyer des soirées de ministres, se faire coacher sur son choix de caleçon par sa monitrice d’autoécole et accepter de décevoir les attentes de ses parents pour s’affirmer. Je ne vais pas vous mentir, la meuf “promise à un brillant avenir” que je suis, mais cantonnée à un job alimentaire à 850 euros par mois qui passe sa vie sur des projets bénévoles qui lui remplissent le cœur (coucou l’asso) s’est énormément reconnue dans ce parcours de déception parentale. En bref, Baise-en-ville est un énorme coup de cœur, feel good, profond, et la rencontre avec Martin Jauvat, naturel et pertinent, a fini de convaincre sur la richesse insoupçonnée de ce film.
Joudi 19 Septemb’
Petite pause de mi-festival, esquive de lacrymos en pleine manif, et on est reparti pour trois séances aujourd’hui !
Dead Lover – Romance odorante
De Grace Glowicki
Avec Grace Glowicki, Ben Petrie, Leah Doz

Crédit BIFF
Un récit frankensteinesque. La promesse d’une mise en scène sublime inspirée des grandes heures de la Hammer. Une histoire d’amour qui transcende les frontières de la mort. Du burlesque et du fantasque. Sur le papier, Dead Lover avait tout pour me plaire, et il était le film que j’attendais le plus de la programmation. La déception n’en est donc que plus vive. Le film est au mieux un ovni cinématographique un peu foutraque, au pire une belle purge suintante de cringe qui se drape d’atours auteurisants pour se donner de la consistance. Ça commençait mal quand l’histoire d’amour démarre parce que l’odeur corporelle repoussante de la fossoyeuse attire son amant coprophile. Reconnaissons-lui tout de même de vraies qualités esthétiques qui piochent allègrement des références à la Hammer, mais aussi au cinéma bis des années 80 avec ses effets et décors en carton pâte. Les maquillages, coiffures et décors, volontairement fauchés, esthétisent ce manque de budget et donnent une proposition plastique originale. Certaines scènes ressemblent à un tableau poudré de l’époque victorienne, d’autres au contraire semblent sortir d’un giallo… Bref, le film est vraiment beau. Et n’a hélas pas grand-chose de plus à offrir. Le jeu des acteurs et actrices, volontairement ampoulé, sur-articulé, théâtralisé, est souvent insupportable. Leurs grimaces les forcent à mâcher à moitié leurs mots. On a l’impression d’assister à un mauvais spectacle d’improvisation clownesque où les comédiens n’auraient retenu que les mimiques insupportables comme mode d’expression. Le choix de casting ultra-restreint est d’ailleurs incompréhensible : des hommes jouent des femmes, des femmes jouent des hommes, et cette ambiguïté ne vient rien traduire de spécial si ce n’est le manque de budget pour engager de meilleurs acteurices peut-être. Des personnages récurrents, de petites vieilles au tricot, de prêtre bigot, de nonnes lesbiennes et de pêcheurs qui s’expriment comme des rappeurs ponctuent le récit d’une présence gênante au possible et qui n’a aucune plus-value. Que dire aussi du récit insipide, qui n’offre ni surprise ni profondeur ? Quel est l’intérêt, le fond, la substantifique moelle de Dead Lover ? Pourquoi prendre tant de détour alambiqué pour raconter… ça ? Le film se termine avec l’impression très vaine d’avoir assisté à 1h30 de private joke entre la réalisatrice et sa (petite) équipe qui voulait se faire un kiff avec un fond de vieux costumes de Tim Burton. Et les références au cul vulgaires en permanence ! Bon Dieu, c’est Scary Movie ou la compét’ du Fifigrot ? Dieu sait pourtant que je suis amatrice de films hors normes, mais vous l’aurez compris, je ne vous recommande pas du tout de voir Dead Lover. Il ne semble pas du tout maîtrisé et ne convainc pas malgré sa belle plastique.
Cuadrilátero – Famille au carré
De Daniel Rodríguez Risco
Avec Lizet Chávez Amil Mikati Gonzalo Molina Valentina Saba
Direction le Pathé Wilson pour la séance de Cuadrilátero. Une famille de quatre vit une existence en apparence idéale. Quatre, c’est pratique pour rentrer dans la voiture familiale. Quatre transats au bord de la piscine. Quatre sets de table parfaitement alignés sur une table carrée. Quatre places sur le canapé familial, tout pile à la longueur du mur. Que faire donc si un cinquième membre non désiré rejoint ce cadre millimétré ? Cuadrilátero explore les diktats familiaux étouffants, où les apparences sociales sont plus importantes que la sincérité des sentiments. L’incapacité pour la mère de famille de régler ses traumas est le point de départ de cette vie étouffante régie par la règle de quatre où le troisième enfant ne trouve jamais sa place. Cuadrilátero est une dystopie du quotidien, où en dehors des murs vertigineux de leur propriété bourgeoise, les personnages vivent une vie plutôt banale, entre école, travail et amourettes. À l’extérieur de leur carcan, la vie suit son cours de manière classique. Du mouvement, de la vie, de la couleur, nous rappellent que Cuadrilátero n’est pas un film de SF dans une société irréelle régie par des codes rigides mais a bien cours dans le même monde que le nôtre. L’intérieur de la maison est si clinique que nous en oublierions presque qu’il existe des possibles, un ailleurs. Les nuances de gris dominent cette maison-prison aux murs impénétrables, une maison en cube, coffre-fort renfermant tous les secrets de cette famille. L’architecture est moderne, les meubles contemporains, l’esthétique minimaliste et dépouillée. Une armoire en bois, sculptée et massive, détonne avec le reste de la décoration. Elle est le premier élément du trouble dans cet ordre parfait. Liée au troisième enfant répudié, cette armoire deviendra bien vite le lieu catalyseur de toutes les angoisses et tensions accumulées au fil des années. C’est un film procédural, avec un scénario “à concept” qui offre cependant une grande richesse de secondes lectures et thématiques. Il ne s’arrête pas à son pitch premier et brode jusqu’au bout du fil tout ce qu’il y a à explorer autour de cette thématique. L’ambiance glaciale de Cuadrilátero n’a pas été sans rappeler la bizarrerie de La Mise à Mort du Cerf Sacré où, de la même manière, l’étrangeté s’insinue dans un quotidien en apparence parfait, où tous les personnages sont impassibles, si rigides dans leurs rôles que même des scènes banales deviennent décalées. Il y a cependant une dose d’humour parfois inattendue dans Cuadrilátero qui nous permet de prendre une distance ironique sur cette famille, qui rappelle qu’ils ont le contrôle sur leurs choix et peuvent avec un peu de volonté se sortir de leur aliénation. J’ai adoré ce film, une vraie pépite froide et malsaine, régie par une mise en scène impeccable et un casting fabuleux. À voir absolument et j’espère qu’il repartira bien classé dans les prix du jury ce dimanche !
Animal Totem – Conte écolo gentillet
De Benoît Delépine
Avec Samir Guesmi, Olivier Rabourdin, Solène Rigot
Benoît Delépine nous le dit lui-même : il se sent “un peu nerveux” pour cette projection à l’American Cosmograph car après tout “C’est mon premier film, j’en suis entièrement responsable !”. Il est vrai que si le réalisateur est connu pour son travail conjoint avec Gustave Kervern, Animal Totem est sa première réalisation d’un long métrage en solo. Cette fable nous place dans la trajectoire du mystérieux Darius, vagabondant avec sa valise à travers champs pour se rendre à la Défense. Cette déambulation le place sur le trajet de nombreux personnages métaphoriques venus délivrer un petit bout de sagesse. Les réalisations du duo iconique sont politisées, et Animal Totem ne fait pas exception à cette règle : ce conte charmant est une attaque frontale contre un Total imagé (ici Totem), une ode à la nature et au fait de retrouver sa place dans le monde animal. Le choix d’image est très original puisqu’il s’agit d’un format encore plus allongé que le Cinémascope afin, selon le réalisateur, “de reproduire la vision de certains animaux” qui ont une vision plus large du monde. Il s’est renseigné sur le sujet précisément pour pouvoir rendre à l’image certaines scènes spécifiques vues à travers le regard d’un chien, d’une abeille, d’une mouche… Samir Guesmi porte magistralement le rôle de ce poète arpenteur mystérieux, plus proche de la figure allégorique de l’humain. Ce casting était une évidence pour Benoît Delépine qui nous confie son coup de cœur pour l’acteur après avoir été jury au festival du film francophone d’Angoulême. Cette année-là, le film de Samir Guesmi, Ibrahim, a raflé quatre prix. Malgré ces bonnes qualités cependant, Animal Totem souffre d’un manque de subtilité qui le fait basculer parfois dans l’écueil de la mièvrerie. Les phrases-poèmes déclamées comme de grandes maximes par les personnages du film sonnent faux et infantilisent un propos écologique pourtant d’une urgence essentielle. La scène de fin, très graphique, nous fait comprendre qu’Animal Totem est bien un conte destiné aux adultes : il aurait été alors préférable de traiter son public comme tel. Nous manquons cruellement de seconde lecture à décortiquer et ressortons du film avec le sentiment d’avoir assisté à une belle histoire, mais trop inoffensive pour avoir le réel impact sociétal qu’elle espère avoir. Dommage, car c’est un film qui n’est pas dénué d’intérêt ni de belles intentions.
Dredi 20 Septemb’
Bigas Luna Tribute – soirée remuante
Voici LA soirée que j’attendais le plus, qui m’a fait frétiller d’excitation depuis son annonce : une rétrospective dédiée au réalisateur Bigas Luna, ainsi que le lancement d’un coffret DVD chez Artus films en présence d’invités d’exceptions. Bigas Luna, c’est un réalisateur que j’ai eu la chance de découvrir lors de l’Extrême Cinéma avec le film Angoisse qui reste une des plus grandes pépites que j’ai pu voir à ce jour. La collègue Lilith avait aussi pu découvrir Caniche à une autre édition du même festival. Les films de Bigas Luna sont rares, surtout avec des sous-titres français. Les voir dans le cadre d’un festival est donc une occasion précieuse à ne pas louper. Je n’ai pas été déçue une seule seconde. Caniche, Angoisse et Bilbao constituent les trois films d’une trilogie informelle dite “la trilogie noire” réalisée en réaction au franquisme. Dans ces films volontairement immoraux, Bigas Luna explore les tréfonds des tabous humains dans des films viscéralement dérangeants. La misère sociale et humaine sont les toiles de fonds de ces films qui explorent la zoophilie, l’inceste, le voyeurisme. Ces sujets crus ne sont jamais exploités gratuitement : Bigas Luna n’a pas la posture auteuriste volontairement provocatrice des auteurs contemporains qui ont besoin de subversion pour se sentir exister (coucou Lars von Trier). Ses films sont portés par une esthétique picturale très riche. Ils se font le portrait de la société des laissés pour compte de Franco, où la censure a fini par créer des monstres. Bilbao et Angoisse sont assez proches dans la construction et la narration : ils sont des plongées dans des psychés dérangées. Ce sont des films claustrophobiques étouffants. Caniche, qui est pourtant le film avec les sujets les plus difficiles, est paradoxalement moins angoissant. Sa construction narrative est plus classique et détachée, nous permettant d’autant mieux de prendre du recul. Cette soirée exceptionnelle nous a été introduite par Betty Bigas, fille de Bigas Luna lui-même, ainsi que par Santiago Fouz, un monument d’érudition sur le cinéma du réalisateur. Pour tout vous dire, j’avais prévu l’écriture d’une chronique sur le cinéma de Bigas Luna à la manière de celle sur Ana Lily Amirpour ou Adilkhan Yerzhanov, mais la présence impressionnante de Santiago Fouz m’a plutôt donné envie de tenter ma chance pour une interview à propos du cinéaste. Il est passionnant et j’aurais pu l’écouter parler durant des heures. Les prochains articles sur le site vous diront si j’ai réussi ou non mon pari, sinon vous devrez vous contenter de mes bien maigres analyses sur Bigas Luna à la place !
Sadi 21 Septemb’
Jambon Jambon – cuisine et maternité
Quand il n’y a plus de Bigas Luna y’en a encore ! Rendez-vous au Pathé Wilson pour assister à la projection de Jambon Jambon, le film le plus connu du réalisateur. C’est le film qui a révélé Penelope Cruz et Javier Bardem, rien que ça ! Et il tranche un peu avec les films de sa trilogie noire. Bien qu’on y retrouve une mise en scène particulière, son obsession pour les gros plans et une certaine angoisse latente, Jambon Jambon est un film plus lumineux, avec de grands paysages ouverts et beaucoup moins malsain. Je ne vais pas vous répéter ce qui a été dit au-dessus, j’espère pouvoir vous produire un article sur ce réalisateur alors rendez-vous très vite sur le sujet !
Pour creuser un peu plus loin cependant, je laisse aux hispanophones le plaisir de découvrir le podcast du Bigas Luna Tribute, le projet porté entre autres par Santiago Fouz : 65 épisodes d’analyses sur le cinéaste, vous avez de quoi vous occuper !
Waarom Wettelen – road trip funéraire
De Dimitri Verhulst
Avec Peter Van den Begin, Tom Vermeir, Dominique Dauwe
Direction l’ABC pour continuer les projections du jour. Vous souvenez-vous du Miracle du Saint Inconnu, découvert lors d’une précédente édition du Fifigrot ? Waarom Wettelen est exactement dans le même esprit pince-sans-rire absurde. Lors des funérailles de Christine, son notaire arrive sur le tard afin de faire respecter ses dernières volontés : elle souhaitait être enterrée à Wettelen. Mais où est Wettelen ? Et surtout… “Waarom Wettelen ?” (pourquoi Wettelen ?). Un long voyage débute alors au pas derrière le corbillard dont le taiseux chauffeur est le seul à connaître l’emplacement de cette mystérieuse ville. Filmé pratiquement intégralement en plans fixes avec très peu de cuts, Waarom Wettelen est avant tout un film sur le comique de situation porté par des dialogues ubuesques. Les moules deviennent une parabole religieuse. La fricadelle, thématique d’un mariage lesbien, est prétexte à digression philosophique. Une grande amitié se crée autour de la diarrhée. Les personnages restent stoïques et dignes face à l’absurdité des situations qu’ils traversent. Le décalage entre leur attitude blasée et ce qu’ils vivent est à mourir de rire. Le casting est brillant. Du père à la tête de chien battu, silencieux et accablé, au fils rejeté beau comme une gravure de mode, en passant par le chauffeur de corbillard baraqué en manque d’amour jusqu’à la chasseuse de veufs venue uniquement aux funérailles pour passer le temps… Il n’y a pas une fausse note dans ce groupe disparate obligé d’avancer ensemble, bon gré mal gré, pour rendre un dernier hommage à leur proche disparue. On rit énormément dans Waarom Wettelen pour peu que l’on aime les films qui prennent leur temps. Très peu de musique et d’effets viennent soutenir les blagues. C’est un film presque austère dans sa mise en scène par moments, ce qui le rend paradoxalement encore plus hilarant. Ce récit initiatique est une exploration de la vacuité de l’existence, des secrets de famille, de ce que la mort vient révéler de plus sincère en chacun. Et le dernier quart d’heure, lourd de sens, termine cette heure et demie d’hilarité en un point d’orgue poétique particulièrement émouvant. Cette facilité à passer du registre comique à l’émotion pure confirme la qualité d’écriture de Waarom Wettelen, une petite pépite du Fifigrot qui est repartie avec une très bonne note de ma part. Espérons que le reste des jurys soit de mon avis pour la remise des prix demain !
Que ma volonté soit faite – Wedding inspo thématique rurale
De Julia Kowalski
Avec Maria Wróbel, Roxane Mesquida, Wojciech Skibinski, Kuba Dyniewicz, Jean-Baptiste Durand

Crédit Unifrance
Petite pause au village du festival et retour à l’American Cosmograph pour la séance du midnight movie (qui est en réalité à 23h mais hey, c’est déjà pas mal pour les trentenaires que nous sommes). Chaque année, le festival met en avant du cinéma de genre et c’est ce film de sorcière contemporaine présenté en avant-première qui a l’honneur d’être proposé cette année devant une salle enthousiaste. Que ma volonté soit faite suit une jeune fille qui rêve d’échapper à son atavisme familial. Enfermée dans sa ferme perdue avec son père et ses frères, abrutie par ses tâches quotidiennes, elle rêve d’un ailleurs, de devenir vétérinaire, même, pourquoi pas. Mais sa mère lui a transmis une malédiction. Un Mal qui la rend incapable de fréquenter le monde. Pourtant, le retour de la fille des voisins va semer le trouble dans sa vie. Certaines scènes du film sont très impressionnantes. La course-poursuite durant la chasse est glaçante de réalisme et de tension. Les scènes de possession sont criantes de réalisme. La souffrance animale dépeinte est insoutenable et marque des moments d’horreur absolue dans le film. Maria Wróbel, l’interprète principale, est magistrale. Son regard envoûtant crève l’écran. Elle hypnotise et fascine par sa présence douce et timide qui devient terriblement angoissante quand son mal la possède… Que ma volonté soit faite reste malgré ses qualités très convenu dans ses propositions formelles. Le feu, la terre, le rituel dans la forêt, l’émancipation féminine, le sang, le sacrifice, l’attirance d’une femme pour une autre, la découverte de la sexualité, le patriarcat, la religion… Tous ces éléments sentent hélas un peu le réchauffé. Même si le placement dans un contexte rural réactualise un peu ces tropes, ce film n’apporte pas grand-chose au genre. On reste un peu sur notre faim en sortie de séance, certaines questions n’ayant pas trouvé de réponse. Pourquoi tant insister sur l’ex de la fille des voisins ? Et pourquoi insister sur la blessure à la jambe de cette même fille ? Qu’est-ce que la maladie mystérieuse des vaches apporte à l’intrigue ? Et pourquoi les personnages ont parfois des réactions si… décalées, comme par exemple quand les filles partent à la chasse à la biche et semblent finalement outrées quand les hommes finissent par tuer ledit anima ? Ce n’est ni un film inutile ni un film honteux, mais qui manque cruellement d’originalité pour être vraiment impactant.
C’est ainsi que s’achève le Fifigrot 2025 pour moi. Je devais aller à la cérémonie de remise des Amphores demain avec la projection des Aigles de La République, mais une angine naissante me fait passer mon tour. Je me suis régalée cette année au festival et je suis contente d’avoir pu profiter un peu des à côtés que je n’ai pas trop le temps de faire d’habitude. Le Gro’Village et son ambiance comico-anarcho-festive est un endroit génial pour faire une pause. Je croise les doigts pour Cuadrilátero, Baise-en-ville et Waarom Wettelen, mes chouchous de cette année pour la compétition, et vous donne rendez-vous très vite pour d’autres articles sur le festival !