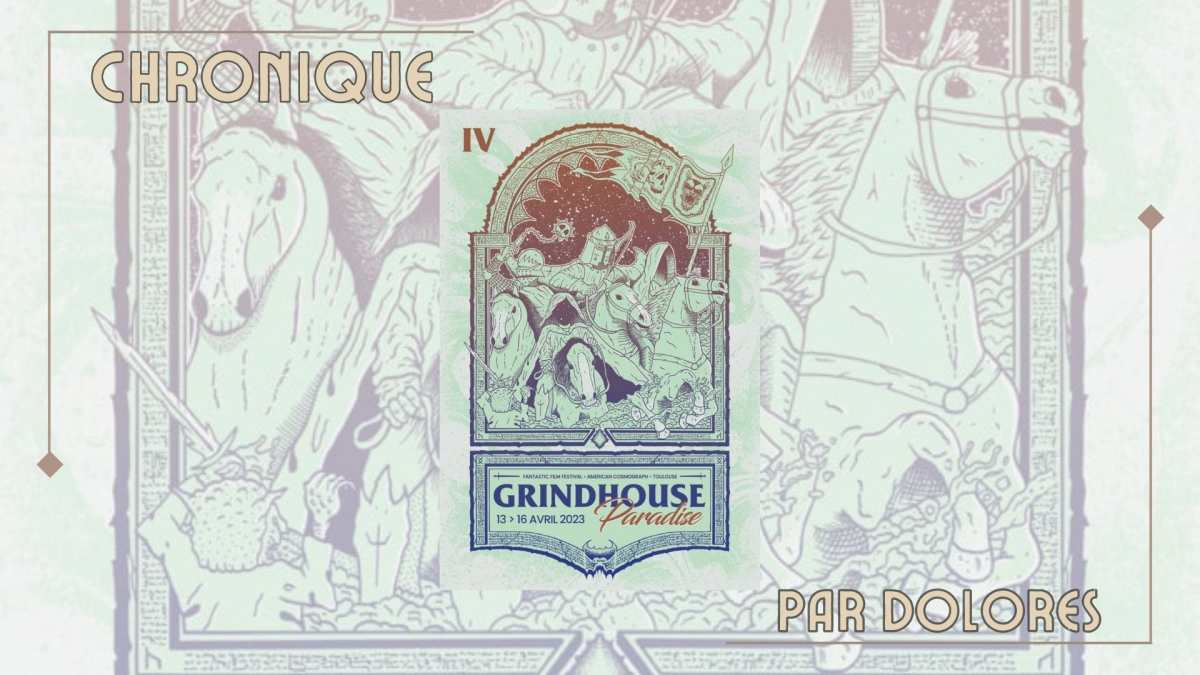La quatrième itération du Grindhouse Paradise a débuté le jeudi 13 avril à l’American Cosmograph dans un hall déjà noir de monde pour la soirée d’ouverture. Un bon présage qui va se confirmer tout au long du festival, la fréquentation des salles ne désemplissant pas même aux horaires les plus compliqués. Plus de 2000 spectateurices ! La programmation éclectique, le nombre élevé d’avant-premières françaises ainsi que les exclusivités ont permis au Grindhouse en à peine 4 éditions de compter dans la cour des grands en matière de cinéma de genre. Petit tour d’horizon des films vus cette année, treize sur les seize programmés.
Soft and Quiet, Beth de Araújo, 1h32 min. Avec Stefanie Estes, Olivia Luccardi, Dana Millican, Melissa Paulo… — États-Unis
Des femmes bien sous tout rapport se réunissent dans une église pour une petite rencontre organisée par Emily, professeure des écoles. Une réunion bien moins innocente qu’il n’y paraît lorsqu’elles évoquent leurs idées suprémacistes blanches. Tandis que la soirée s’envenime, Emily perd totalement le contrôle…
Un film édifiant, qui marque un démarrage très fort pour le festival. Soft and Quiet est tourné entièrement en (faux) plan séquence, nous entrainant dans une lente descente aux enfers que l’on comprend inéluctable dès le sujet de la réunion révélé. Il vaut mieux ne pas trop en savoir pour préserver l’effet choc des 20 dernières minutes, cauchemardesques. Malgré la brutalité de son thème, Soft and Quiet n’est jamais vulgaire ou gratuit : la violence se met au service d’un propos sur l’urgence de la question de la montée en puissance des groupes suprémacistes blancs aux USA. Un message d’autant plus fort qu’il est porté par une réalisatrice concernée par les violences racistes. Elle place ironiquement le point de vue de son film au sein de ce groupe suprémaciste blanc avec un regard non dénué d’humour pour mieux en étudier les dynamiques : d’une bêtise crasse à une haine froide et réfléchie, ces femmes sont liées par un sentiment constant de persécution, blâmant les étrangers pour n’importe lequel de leur problème. La violence est filmée en hors champ, la rendant paradoxalement encore plus viscérale, l’imagination ravageant plus que l’explicite. Les actrices sont excellentes, Olivia Luccardi (que l’on a vu la même année dans Candyland, présenté à la soirée d’ouverture du Grindhouse) exceptionnelle en primo-arrivante un peu naïve, mais impulsive et dangereuse, et surtout Stefanie Estes qui incarne à merveille la mesure et le calme du titre, une façade pour davantage donner du crédit à ses idées nauséabondes. Soft and Quiet est un film coup de poing indispensable. Produit par Blumhouse, une valeur sûre dans le cinéma de genre dont les films bénéficient souvent de sorties en salle, on espère une date de distribution française rapide !
Mad God, Phill Tipett, 1h24 min. Avec Alex Cox… — États-Unis
Une plongée dans les bas-fonds d’un monde en ruines où l’on suit L’Assassin. Ses sombres desseins se perdent dans un labyrinthe de paysages étranges, repaire d’une faune inquiétante et féérique.
Si Phill Tipett est un grand nom que l’on ne présente plus, maître des effets pratiques et des créations de monstres en animatroniques, son film Mad God restait un lointain fantasme de fan à jamais égaré dans l’enfer du développement depuis la fin des années 80: trop ambitieux, trop coûteux, trop délirant pour son époque…. Il a pourtant été ressuscité par trois campagnes kickstarter successives pour une sortie définitive en 2021, 30 ans après le début du projet. Si le résultat démontre une indéniable maestria sur le plan visuel, avec son animation en stop motion impressionnante dans des décors en maquette tous plus inventifs, tordus et bizarres les uns que les autres, le fond convainc bien moins que la forme. Certaines métaphores paraissent évidentes (une critique de la religion et du rôle omnipotent de Dieu, critique du capitalisme qui traite le corps humain comme de la chair à canon avec de belles références à The Wall…), mais le sens global de la quête de ce personnage dont on finit par perdre la trace est bien confus. Et au bout d’une heure et demie de crasse, de fluides corporels douteux, de boue, de fumée, de noirceur, de monstres déformés, de bubons purulents et de machines grinçantes, toutes impressionnantes que sont ces marionnettes et ces maquettes, le résultat réussit quand même à lasser. Tout ça pour ça finalement ? Si vous êtes curieux et souhaitez découvrir cet ovni cinématographique qui vaut tout de même le coup d’œil, ne serait-ce que pour voir enfin l’accomplissement d’un film attendu pendant 30 ans, ça se passe à partir du 26 avril à l’American Cosmograph !
Watcher, Chloé Okuno, 1h36min. Avec Maika Monroe, Karl Glusman, Burn Gorman, Madalina Anea… — États-Unis/Roumanie
Julia vient tout juste d’emménager en Roumanie pour suivre son mari, pays où elle ne connaît personne et ne maîtrise pas la langue. Elle est souvent seule dans leur grand appartement et s’ennuie en laissant son regard se promener sur l’immeuble d’en face… Jusqu’à ce qu’elle remarque qu’une silhouette semble l’observer elle aussi, et qu’elle commence à se sentir traquée dans la rue…
Watcher est un thriller psychologique extrêmement conventionnel. Dès que les bases sont posées, on en devine tout de suite la fin, tant il emprunte les traces des grands classiques du genre : Fenêtre sur cour, Faux témoin, Body double… Voire même une petite pointe de Lost in Translation et autres récits de la solitude de primo-arrivants dans un nouveau pays. Pourtant la maîtrise de son ambiance, lente, et glaciale, la qualité de sa mise en scène léchée à la photographie millimétrée et son casting irréprochable (Maika Monroe, figure montante du cinéma de genre contemporain) font de Watcher un thriller devant lequel on passe un bon moment. Un premier film déjà très mature malgré sa facture classique, à la mise en scène soignée. Sa plus grande qualité réside dans son écriture solide. Le récit ne se perd jamais en digressions inutiles, et son sous-texte féministe est aussi un point fort de ce récit où la parole des femmes est constamment méprisée, ce qui entraine des conséquences désastreuses. À voir depuis le 12 avril sur des plateformes de VOD !
La Gravité, Cédric Ido, 1h26 min. Avec Max Gomis, Jean-Baptiste Anoumon, Steve Tientcheu, Olivier Rosemberg, Hafsia Herzi… — France
Le destin croisé de Daniel, Joshua et Christophe, trois amis d’enfance que le temps a éloignés, qui vont se retrouver mêlés aux Ronins, un gang de jeunes qui fait la loi dans la cité. Ils paraissent mystérieusement fascinés par l’alignement des planètes à venir, qui semble rendre tous les habitants anxieux et fait peser un climat lourd, très lourd, dans la cité…
Quelle ambiance réussie pour ce premier long-métrage de Cédric Ido, qui s’inscrit déjà parmi les grands films marquants du cinéma de genre à la française ! Entre récit à l’atmosphère crépusculaire, terreur sourde de la fin du monde, références pop culture, patchwork d’inspirations piochées dans les différents cinémas de genre, propos politique sur la pesanteur aliénante de la solitude des banlieues, histoires de vies écorchées par les conséquences de cette aliénation, La Gravité brasse une quantité de thématiques et d’inspirations riches qui respire l’envie de bien faire. Max Gomis, qui n’avait jusque-là eu que des rôles confidentiels, trouve dans le personnage de Daniel un protagoniste à l’aura rassurante d’un grand frère, à la hauteur de son jeu tout en nuances et naturel. Il convient enfin de souligner la beauté visuelle de ces plans hors du temps qui ponctuent le récit. Le film s’autorise des pauses surréalistes avec des paysages fantasmés dans l’espace, des aires contemplatives avec de magnifiques prises de vue de couchers de soleil sur la banlieue, le tout avec un travail poussé sur la couleur et la lumière. L’univers de La Gravité est très personnel, le film brise les codes en proposant une création riche et individuelle. N’hésitez pas à lire notre article intégral sur le film une fois mis en ligne. Il sortira en salles le 3 mai, ne le loupez pas !
Megalomaniac, Karim Ouelhaj, 1h41 min. Avec Benjamin Ramon, Eline Schumacher, Wim Wallaert… — Belgique
Et si le Dépeceur de Mons, ce célèbre tueur en série belge jamais retrouvé, avait eu des rejetons ? Auraient-ils marché dans les traces de leur père ou tenté de se défaire de son héritage ?
Qu’on se le dise, la question est vite tranchée par la brutalité de l’entrée en matière du film : un accouchement sanguinolent et traumatique sous les yeux d’un enfant que l’on sent habitué à l’hémoglobine. Le film est violent, abrupt, vraiment graphique, sans doute le plus ouvertement sanglant du festival, mais pourtant très très beau. Aux scènes brutales succèdent des scènes surréalistes, très esthétiques, aux contrastes colorés magnifiques et aux inspirations picturales évidentes. Les deux gamins — devenus adultes — du tueur en série sont interprétés par Benjamin Ramon et Eline Schumacher, tous deux terrifiant dans ces rôles de personnages traumatisés qui reproduisent le cycle de la violence. Avec un tel sujet, le film pourrait être complaisant et gratuit, mais c’est un travers dans lequel il ne tombe jamais, préférant s’interroger sur ce qui génère le mal plutôt que d’en dresser un état des lieux arbitraire. Le film se déroule sur une période assez longue, mais la perception du temps est totalement déformée, nous faisant éprouver cet enfermement mental permanent dans lequel ils vivent, avec des journées qui se succèdent et se ressemblent perpétuellement. C’est un long-métrage sombre, pessimiste et désespéré, qui a été beaucoup comparé pendant la présentation à la french horror du début des années 2000 (Martyrs, A l’intérieur…), qui réussit à la perfection son coup. Un film malsain au propos de fond impactant, dont on espère une sortie prochaine au cinéma !
Skinamarink, Kyle Edward Ball, 1h40 min. Avec Lucas Paul, Dali Rose Tetreault… — Canada
Deux enfants n’arrivent pas à dormir la nuit. Ils se lèvent et décident de chercher leur père, introuvable. Les portes et les fenêtres de leur maison ont disparu. Quelque chose semble rôder à l’étage.
Je triche ici puisque je n’ai pu rattraper ce film qu’après le festival (la séance du matin elle pique toujours un peu trop…), mais sans le Grindhouse Paradise, je n’aurais sans doute jamais entendu parler de cet objet cinématographique étrange, entre le film expérimental, le conte noir et l’essai psychologique. Skinamarink est un film d’ambiance, d’images, de contextes, qui ne parlera clairement pas à tout le monde surtout au vu de sa forme cryptique, de son absence de récit précis et de son rythme très lent. Mais l’expérience peut être terrifiante si on se laisse porter par son atmosphère singulière, elle le fut pour moi en tout cas. Plusieurs jours après, ce film continue de me hanter. Avec son esthétique proche des liminal spaces, très en vogue en ce moment avec les mythiques backroom, ses sons constamment brouillés par du bruit blanc et le grain de son image abîmée, qui fait surgir des projections mentales au milieu des noirs imparfaits, on tient la recette d’une immense machine à cauchemars. Je suis en pleine lecture de La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski, livre passionnant à la forme étrange qui conte l’histoire d’une maison qui n’est pas fiable, où l’espace change de dimension en permanence et où la notion de foyer rassurant est pervertie. Skinamarink serait une excellente transcription visuelle de cette expérience psychédélique. C’est un objet filmique déroutant, fascinant et hypnotisant, aussi intéressant à vivre qu’à analyser. Je vous recommande à ce titre la remarquable vidéo de Wendigoon pour aller plus loin sur le sujet. Comme le furent Blair Witch ou Paranormal Activity en leurs temps, Skinamarink, réalisé avec un budget dérisoire, prouve que le minimalisme est le meilleur moyen de faire surgir la terreur : le cerveau humain excelle dans l’autopersuation d’un danger imminent… Si vous avez un VPN, le film est disponible sur Shudder depuis le mois de février, et des projections en salles françaises sont prévues en mai !
Good Boy, Viljar Bøe, 1h16 min. Avec Gard Løkke, Katrine Lovise Øpstad Fredriksen, Amalie Willoch… — Norvège
Lorsque Sigrid fait la connaissance de Christian sur un site de rencontre, un homme parfait sous tous rapports, elle ne se doutait pas qu’il vivait avec Frank, son chien… Qui est visiblement un être humain dans un costume de canidé.
Sous son postulat de départ absurde, Good Boy cache un long-métrage très intelligent sur les relations d’emprise, la toxicité et la manipulation. Si l’on rit de bon cœur pendant la première partie face à la confusion de Sigrid envers Frank, cet homme qui se comporte en chien sans être motivé par un kink sexuel, l’ambiance devient vite de plus en plus pesante. Les débuts innocents de cette comédie romantique sont rapidement teintés de malaise : au-delà de l’originalité de Frank, Christian semble toujours dire le mot de trop qui suscite la gêne. Dans le plus pur esprit scandinave, le film est minimaliste dans ses effets et travaille avant tout ses cadrages et ses dialogues pour distiller son propos. Le silence est aussi primordial, les pauses s’étirant pile assez longtemps pour devenir étranges. Gard Løkke campe un Christian parfait, beau, gentil, attentionné… et tout à fait glacial derrière son apparence si lisse, et ce dès les premières secondes. Il n’est jamais naturel ce qui contraste d’autant plus avec la sympathie de Sigrid qui elle semble à l’aise en toutes circonstances. Elle cherche à comprendre Frank, ne juge pas et finit par jouer le jeu avec cet homme chien, clé de voûte de l’intrigue. La fin de Good Boy est glaçante, une fin coup de poing représentative de ce décalage ironique mordant et noir des films scandinaves. Une pépite à voir malheureusement en festival, ou en VOD sous-titrée anglaise, car c’est une rareté introuvable dont aucune date de sortie n’est prévue à ce jour !
Lola, Andrew Legge, 1h19 min. Avec Emma Appleton, Stefanie Martini, Rory Fleck Byrne… — Irlande/Angleterre
Deux sœurs construisent une machine qui capte les ondes radio venues du futur. Elles la baptisent Lola, du nom de leur mère, et s’en servent pour faire le bien autour d’elles pendant la Seconde Guerre mondiale… Jusqu’à ce qu’elles comprennent que les changements dans le présent auront un impact parfois dévastateur dans l’avenir.
J’aimerais apprécier Lola tant il a d’indéniables qualités. C’est un vrai film d’artiste, Andrew Legge a passé des mois à récolter des images d’archive, à trouver des lentilles et pellicules d’époque pour tourner de la manière la plus authentique possible (vous croyez qu’il a croisé Robert Eggers, en pleine recherche de lentilles pour the Lighthouse sur les marchés aux puces ?), les visuels sont magnifiques et les actrices exceptionnelles. Mais rien à faire, l’ensemble ne prend pas. Le film est brouillon tant dans la forme que dans le fond : le tremblement incessant de la caméra, le montage très cut qui vacille, la pellicule abîmée qui saute… Tout ça fatigue très très vite. Même si ces choix esthétiques sont cohérents avec le propos, des pauses auraient été appréciables, d’autant que tout est précipité. De la construction de la machine dans l’enfance des filles jusqu’à leurs aventures à l’âge adulte, on prend au final peu le temps de poser le contexte et d’apprendre à les connaître. On est souvent perdu dans les références historiques, les dialogues sont assez techniques, et on a parfois du mal à savoir qui attaque qui, où et comment : les stratégies utilisées par les sœurs manquent fréquemment de clarté, et la présence de la voix off ne nous éclaire pas plus. Un film au postulat intéressant, mais qui se paume beaucoup en cours de route, et ne tient jamais son principe d’être un documenteur/found footage, il y a beaucoup d’incohérences dans les cadrages par exemple. Le résultat est, hélas, assez pesant. Pas de nouvelles sur une date de sortie pour le moment !
The Origin, Andrew Cumming, 1h27min. Avec Kit Young, Chuku Modu, Iola Evans, Luna Mwezi… — Angleterre
À la préhistoire, Adem mène un petit groupe d’Homo Sapiens à la découverte d’un nouveau territoire inexploré… Et hostile : bien vite, d’effroyables créatures viennent les persécuter pendant la nuit jusqu’à la terrible disparition de Héron, le plus jeune fils d’Adem.
Quelle ABSOLUE réussite ! The Origin est impressionnant pour un premier film, à la fois dans la maturité de son écriture et dans la prouesse de son ambiance terrifiante. Le foyer de lumière délimité par le feu de camp est un espace au-delà duquel tout est possible, faisant ressurgir une peur du noir viscérale, primitive. Le sound design et la musique sont particulièrement réussis. Travaillé en Dolby Atmos, le son voyage autour de nous, les créatures nous entourent au sens propre, nous rendant tout autant vulnérables que les personnages. C’est un des films les plus viscéralement terrifiants que j’ai vu depuis It Follows, qui se démarquait aussi par son ouvrage remarquable du son. Les recherches menées sur les costumes et les armes en passant par la création d’une langue originale, le Tola, contribuent à la prouesse de ce film. The Origin, c’est le retour aux origines bien sûr, mais aussi le récit de l’origine de la violence humaine. Une chronique nihiliste qui interroge sur la nature de l’humanité, sur l’aptitude à faire groupe… Sommes-nous pourris de l’intérieur par nature, incapables de penser au-delà de nos cercles sociaux restreints ? Une création ambitieuse, originale, réussie tant sur la forme que sur le fond, et les spectateurices ne s’y sont pas trompé-es puisque ce film a gagné le prix du public du festival. Espérons que cette récompense l’aide à avoir une distribution en salles d’ici la fin de l’année. En attendant, n’hésitez pas à consulter la critique plus étayée du film disponible sur le site de l’asso !
The Spine of Night, Morgan Galen King, Philip Gelatt, 1h34 min. Avec Lucy Lawless, Richard E.Grant, Patton Oswalt, Betty Gabriel… — États-Unis
La prêtresse Tzod, chassée de son marais, lutte contre le Mal qui s’est emparé de la magie des anciens dieux. Elle retourne à la source des pouvoirs pour trouver une solution et sauver ce qu’il reste de l’Humanité.
Allez, je triche pour celui-ci puisque je l’avais déjà vu avant le festival, merci Shadowz ! C’est une curiosité teintée de nostalgie très plaisante, aux thématiques étonnamment graves. The Spine of Night, avec son animation en rotoscopie, son esthétique comics 80’s et son histoire épique que l’on croirait tout droit tirées d’une série heroic fantasy rétro, parlera à tous les fans de Donjons et Dragons de la première heure, mais aussi aux personnes qui s’intéressent à cette période dans la mouvance du revival 80’s que l’on a connu ces dernières années. Le casting est mené par une vedette mythique du petit écran qui a bercé les imaginaires fantastiques de l’époque : Lucy Lawless, la grande et unique Xena la Guerrière. Elle campe la prêtresse Tzod, qui, fait notable, est nue durant tout le film sans être sexualisée et possède un corps réaliste loin des standards disproportionnés dans la fantasy de l’époque. Il serait pourtant dommage de ne réduire The Spine of Night qu’à cette simple dimension référentielle tant il offre un récit intéressant, touchant à de grandes questions métaphysiques sur l’Humanité : le savoir doit-il être partagé ou détenu par une élite capable d’en faire bon usage ? Une épopée passionnante dans une animation originale, à voir sur Shadowz !
Dawn breaks behind the eyes, Kevin Kopacka, 1h14min. Avec Anna Platen, Jeff Wilbusch, Frederik von Lüttichau, Luisa Taraz… — Allemagne
Un couple sur le bord de la rupture va visiter un château à l’abandon hérité d’un oncle. La nuit commence à tomber et le temps semble s’étioler dans cet étrange lieu, habité par une présence…
Ce film séduit avant tout par sa beauté plastique. Le réalisateur vient de l’univers du clip, de la mode et des vidéos promotionnelles. Son sens de l’esthétique s’en ressent, ses cadrages sont millimétrés, ses couleurs magnifiques, il y a une grande technicité et un usage de références précises derrière ses images. Dawn breaks behind the eyes se situe dans les années 70, la première partie du film pourrait sembler avoir été tournée à cette période tant la reproduction du style, des musiques et du montage d’époque est fidèle. Il aurait pu se contenter d’être un bel hommage à l’euro gothique des années 70 sauce vampires et château mystérieux. Il nous aurait donné un objet cinématographique esthétique, volontairement rétro, mais sans grand autre intérêt qu’un exercice de style. La saveur de ce long-métrage vient en deuxième partie, lorsque le ton change brusquement grâce à un retournement scénaristique dont il convient de ne pas gâcher la surprise en vous en révélant la teneur. Sachez juste qu’il amène un vrai souffle de fraîcheur, du second degré et de la profondeur à un récit jusque-là assez standard. Vous connaissez Dance Macabre de Ghost? Ce film nous offre l’occasion de voir ce que ce clip aurait pu donner en long-métrage ! La maestria visuelle reste le maître mot jusqu’au bout : Dawn breaks behind the eyes est peut être le film le plus beau de tout le festival. L’histoire est parfois confuse, le sens global échappe un peu, mais il est une jolie pépite archi référencée, originale, avec une réelle personnalité et qui ne se contente pas de vivre qu’à travers ses évocations nostalgiques. C’est aussi un film disponible sur Shudder et qui vaut vraiment le coup d’œil !
Assault, Adilkhan Yerzhanov, 1h30 min. Avec Azamat Nigmanov, Aleksandra Revenko, Nurbek Mukushev… — Kazakhstan
Dans une école perdue à Karatas, un village fictif du Kazakhstan, un prof de maths enferme ses élèves avec des terroristes venus faire une prise d’otage. Honteux, et face à l’inaction des forces de l’ordre, il décide de monter un petit groupe d’assaut fait de bric et de broc pour libérer les enfants.
Adilkhan Yerzhanov ne cesse de me séduire de film en film, c’est pourquoi j’ai choisi de lui consacrer bientôt une chronique entière pour revenir sur les spécificités de son cinéma, comme j’avais pu le faire l’an passé avec Ana Lily Amirpour. Assault est la plus ouvertement absurde et comique de ses réalisations, bien que l’humour ironique noir soit une de ses marques de fabrique : on rit de bon cœur, mais la gravité n’est jamais loin. Les enjeux de ses films sont toujours d’une importance cruciale, souvent des combats entre la vie et la mort. On explore dans Assault une fois de plus un cinéma humaniste, où des losers magnifiques finissent par se sublimer au contact du danger, et où chaque personne, même la plus marginale, est un maillon indispensable d’une dynamique de groupe. On retrouve également un regard grinçant sur l’incompétence policière, à la fois trop pauvre pour agir, mais aussi trop lâche et embourbé dans une lenteur administrative qui l’entrave. Assault est un film somptueux, capturant un Kazakhstan enneigé avec une attention pleine d’amour qui magnifie jusqu’aux bâtiments en béton brut délabrés qui ponctuent les paysages désertiques de Karatas. Le film se déroule souvent entre chien et loup et a un travail de lumière impressionnant lui permettant d’exploiter des contrastes lumineux marqués, proche du clair-obscur. Le récit est parfois alambiqué, le découpage temporel pas toujours pertinent et les non-motivations du groupe de terroristes assez floues, comme tous les films d’Adilkhan Yerzhabov, il a une rythmique assez particulière et anticlimatique. Mais rien à faire : son cinéma me touche jusqu’à l’âme. Assault est une de mes meilleures séances du Grindhouse Paradise, et un des meilleurs films d’Adilkhan Yerzhanov. Un régal à découvrir le 12 juillet en salles !
Missing, Shinzo Katayama, 2h04 min. Avec Jiro Sato, Aoi Itô, Hiroya Shimizu… — Japon
Une adolescente vit avec son père, dépressif depuis la mort de sa femme. Il est criblé de dettes et pense que pourchasser Sans Nom, le tueur en série qui sévit dans la ville, va lui permettre d’empocher la récompense et de mettre sa famille à l’abri. Mais quand il disparaît, sa fille doit se lancer à son tour sur les pistes de son père, quitte à découvrir ses plus sombres secrets…
Si le récit d’un traqueur traqué par sa fille est original et intéressant, Missing souffre de longueurs qui l’empêchent d’être pertinent. Le personnage de la jeune adolescente est attachant, elle est futée, drôle et avec un caractère bien trempé, mais ses déductions semblent parfois bien artificielles, comme trop surécrites: ça manque de cohérence et de vraisemblance. Beaucoup de péripéties arrivent par hasard, des raisonnements réalisés un peu à la volée sur de petits détails se révèlent véridiques… De même, le film force beaucoup trop sur les retournements de situation. Le rythme est mal géré, et le choix d’une narration non linéaire est discutable en termes de logique narrative. Ainsi, le retournement principal surgit au milieu du récit, crevant le suspens pour faire sombrer le reste de l’histoire dans un drame assez maladroitement mené et larmoyant. Les personnages, en dehors de l’adolescente, ne sont pas très attachants, rendant encore plus difficile le fait de suivre cette quête qui s’éternise. La pire écriture revenant sans doute au tueur en série, Sans Nom, qui est un cliché de psychopathe assez risible, enfilant les lieux communs du fétiche sexuel jusqu’au plaisir de la torture comme dans les plus mauvais polars pour faire trembler les vieilles rombières. Même le propos de fond sur la fin de vie et le droit au suicide assisté se retrouve englué dans une lourdeur scénaristique qui ne lui donne pas l’espace de se développer. Un film de clôture qui n’a pas été, à mon sens, à la hauteur des magnifiques pépites que l’on a pu découvrir pendant le festival !
Si vous êtes arrivé-es au bout de cet article, félicitations ! J’espère vous avoir donné envie de découvrir certaines pépites du festival et de vous jeter sur les nouveautés lors de leur sortie en salles. Et parce qu’on est sur Internet et qu’Internet adore les tops, mon petit classement perso des films vus durant le Grindhouse Paradise :
1/ The Origin
2/ Soft and Quiet
3/ La Gravité
4/ Assault
5/ Good Boy
6/ The Spine of Night
7/ Skinamarink
8/ Watcher
9/ Megalomaniac
10/ Dawn Breaks behind the eyes
11/ Lola
12/ Mad God
13/ Missing